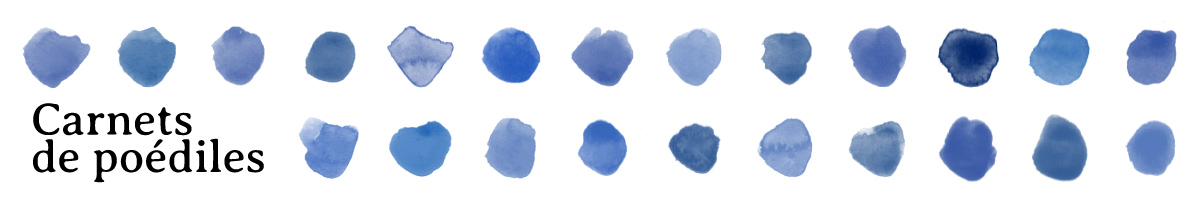Parfois, de la lecture de poèmes naissent d’autres poèmes. Emmanuel Merle nous a aimablement confié cinq textes qu’il a composés en 2022 et 2023 pour un livre de vingt-trois poèmes assez longs qui s’intitulera “Les enfants de Saragosse”. Pour leur auteur, “chacun de ces textes est né du désir d’écrire un poème d’après un autre poème, un tableau ou une sculpture de Giacometti”. Les cinq poèmes inédits qui suivent prennent chacun leur “source” dans un poème de Seamus Heaney, Roger Caillois, Georges Séféris, William Butler Yeats, ou encore Yves Bonnefoy.
Pare-brise
(d’après « Amants aux îles d’Aran » de Seamus Heaney)
les vagues s’éboulent bruit de papier froissé
de pare-brise lentement explosé comme un échec
un renoncement à l'équilibre un siège immémorial
l’île abdiquera mais dans longtemps
Aran
nom propre et cri
du grand effort violent
quand on tire une barque sur la grève
le geste pour échapper aux incisives de la mer
existe-t-il encore
cette frange mouvante
l’estran des squames de deux visages
qui s’écorchent
Aran de Buren Aran d’Irlande errante
navire immobile sous la marée courante
falaises visages rincée d’aube fine
l’île trois points de suspension terraqués
sous le ciel labouré aussi fragmenté que du karst
la lumière intérieure des vagues palpite
éclaire la salive de l’océan
bouts d’écume éclats de roche
les macareux et les cormorans
se tiennent là
gardiens de l’inconciliable passion
de l’air du calcaire et de l’eau
être à la lisière de la guerre
ne pas désirer savoir qui gagne
qui perd
le grand effort de l’océan sa sueur d’ahan
retombe sur le billot de la terre
ainsi naissent et vivent les mots et les oiseaux
que le temps éclabousse
comme un enfant têtu et jamais sevré
piétine le miroir de la flaque
et brise en vain son reflet
Aran
je voudrais moi aussi rester dans la rumeur
de ta falaise observer mon visage de pierre
immobile lentement érodé faire ruisseler
mes mains sur mes joues
accepter enfin le poudroiement de mon corps
la vapeur et la brume finales de son éparpillement
Être pierre
(d’après Pierres de Roger Caillois)
tu as dit l’éternité des pierres humbles
leur silence
leur façon d’être sans exister
tu as dit leur patience inutile
leur intérieur roturier
les haillons moirés l’eau qu’elles recèlent
ce bloc d’anthracite
une épaule
ce caillou du sentier
un signe
tu as dit
pierres semées sur un jeu d’échecs
pierres dans le hasard créateur
l’univers mis en abyme
le lichen interne qui écrit les arbres
les ports et les mâts, les villes du futur
le regard de l’homme avant l’homme
sous l’inconscient des pierres
la poésie qui ne se sait pas
mais il faut dire aussi leur tendresse
l’os poli de leurs épaules dénudées décharnées
dans le bouleversement incessant invisible
du corps de la montagne
je dis cette mort tranquille laïque
les pierres nous accompagnent
de petits genoux sortent humblement de terre
des crânes émergent à peine solidaires
je voudrais dire la pierre anonyme et dense
erratique tombeau charrié par le glacier
dans sa migration lente
la pierre noire et scintillante tombée d’un ciel nocturne
secrète silencieuse et solitaire
dans l’enchevêtrement et les plis des pressions telluriques
sans leçon ni désir
fragments toujours entiers
pierres froides mais inexplicables alliées de l’œil
dos tournés hasardeux complices de mes mains
pierres vous avez lieu
dans l’évidence
sans grade ni grâce sans géométrie insensée
ni miracle triangulaire sans valeur ajoutée
je dis la pierre du chemin la pierre
détachée soudain de la face maternelle
sans ailes ni vertige la pierre illisible et pauvre
le calcul et le galet
la ponce et le sable
la roche dont le nom ruisselle
le roc sans épée sacrée
le talisman inachevé et l’éternité friable
Agios Sostis
(d’après « Le roi d’Asiné » de Georges Séféris)
nous cherchions un signe
quoi d’autre
dans la beauté du paysage une intimité enfantine
un sauf-conduit pour notre présence
sur l’île de la Grèce malade
soleil frère de la mort
soleil des départs pour la guerre
ciel bouclier
près du sanctuaire d’Agios Sostis
sans autre source que le bleu et le blanc
sur la pierre brisée sanguine des anciennes mines d’argent
puis sous la terre ferreuse
nous espérions une âme
une empreinte abandonnée dans l’ombre
au dehors sur le dôme armé
la guerre était livrée en plein midi
le fracas de la lumière sur la mer silencieuse
éclatait en gouttes de sang sur les rochers
les anémones rouges découvertes par l’eau
palpitaient tomates soyeuses
les dieux étaient partis
nous étions seuls au monde
un signe
le visage des disparus leur âme
les mains pressant d’autres mains dans la peur présente
le drame des voix en allées
plus rien que le désert
et peut-être l’écho de ce qui fut
dans la transparence glauque de l’eau
suçant les pierres du rivage
parce que le désert a sa façon étrange
de montrer ce qui ne peut être montré
l’absence
le désert surtout est preuve absurde
de l’ancien peuplement et du sang
versé sur les pierres
un sang si profondément incrusté dans leur âme
aucune montée primitive des eaux divines
n’a pu l’écailler
pierres rouges gorgées
d’un sang si sec
aucun fantôme échoué ne s’y abreuve
soleil frère de la mort
soleil des départs pour la guerre
Ciel bouclier
l’écrin du désert enferme
l’or l’argent et le fer de la lèvre des enfers
et dans le palais obscur de la mine
ma main au lieu de la tienne
n’a pu saisir que l’air épais
mêlé d’autres mains évanescentes et ouvertes
comme des offrandes sans chair ni destin
des gestes abandonnés
les âmes mouvantes des morts emplissaient cette bouche
chacune un mot désormais imprononçable
chacune une labiale voulant franchir le silence
et marcher encore
les êtres chers en allés
tombés derrière le rebord du monde
et tous ceux du passé tragique
abandonnés dans les pierres le lichen
meurtris au bord du vase immense de la mer
ayant vécu en vain
***
nous sommes sortis de la mine
le soleil moins haut levait
quelques ombres nous parlait
sur le petit escalier du sanctuaire
tu étais là dans le blanc du mur le bleu du toit
et de la mer
dans ce tableau délaissé par le temps par le désert
de son histoire
dans l’évidence que le présent
d’une seconde à l’autre
rétablissait abolissait la cohérence de l’île
les pierres déchirant l’œil malgré la paupière des nuages
l’eau et le ciel seulement les couleurs d’un peintre
la terre désormais veuve
je t’ai vue debout et j’ai connu le signe
alors
dans l’éclat incertain de fin d’après-midi
qui semble attendre qu’un espoir
se dresse avant le soir
ce fut comme si un peuple sombre se pressait
près du sanctuaire d’Agios Sostis
peuple d’argent et de fer qui par ta présence
percevait à nouveau la complétude de son geste
aimait la lumière du jour finissant
lumière seule
diffuse déjà familière
Le vent des fous
(d’après « Fou comme brume mêlée de neige » de W.B.Yeats)
cette maison l’hiver maison de congères
de stalactites et de sentiments recuits
arrimée à janvier j’ai vu la cheminée
allumée trois fois pour des noëls tristes
tendus comme des câbles au-dessus du vide
et dehors la poussière de neige
la respiration froide d’une saison mentale
l’assaut du vent sauvage toute une enfance
au bord de la folie
les livres servent de parapet
parfois la vie entière
mais un livre n’est pas un membre
n’équilibre pas l’oreille interne déroutée
la nostalgie du possible est dans ma tête
comme un vent sauvage
l’ancienne neige était si primitive si violente
si résolue qu’elle a créé son propre souffle
sur mon visage et mes mains elle a écrit
un braille éphémère
visage et mains grêlés d’un alphabet
étrange et insensé
aucun livre jamais aucun mot
quelques noms propres peut-être
la vibration de la neige et du vent est en moi
vivante incohérente forêt sombre
le vent des fous disait-on et on fermait les yeux
nous étions de même nature
de la même horde
mutique et mugissante
cette maison l’hiver glacée de l’intérieur
emprisonnée par les livres
cernée de visages
que visitent mes rêves
le vent des fous me parcourt encore
une rumeur grondante une basse obstinée
dans l’oreille d’un sourd
il y avait tant de livres des sacs de sable
inutiles sous la mitraille perméables à la brume
lente une suie collante
et les mots sur les pages s’éteignaient sous les cris
aujourd’hui que tout est dissipé
que la neige a reflué comme les ondes
craquantes d’une ancienne radio
abrité dans le long corridor des années
je voudrais parfois retourner
pour percer la brume et braver le vent
Champblanc
(d’après « Hopkins Forest » d’Yves Bonnefoy)
la neige enflamme en moi les braises de l’enfance
la nuit simple ouvre son rideau
et des secondes légères et blanches tombent
en désordre
se déchargent au sol de leur faible voltage
je passe
je marche sur le trottoir de congères durcies
la forêt est revenue dans la ville les guirlandes
éclairent les rues
comme sur un tableau noir les craies de couleur
il n’y a pas encore de mots
je me souviens de la forêt de Champblanc
qui connaît la brume d’automne
les châtaignes les perles parfaites
d’une langue étrangère
les rails abandonnés de la mine d’anthracite
la brume et le givre de novembre font pâlir
la silhouette d’un qui se penche
pour assembler papier brindilles et branches
que pense-t-il qu’il ne me dit pas
le ciel blanc est descendu jusqu’à nos fronts
je n’ai jamais été aussi proche de lui
qui pourtant paraît se désagréger
devenir un brouillard de flocons
sans mémoire
comme devant du sang sur la neige
je suis resté devant le feu
présent à l’être de courtes flammes bleues
tordant les bras des branches qui grésillaient
présent aux vers rouges qui palpitaient dans le bois
et à ce qui n’avait pas encore de nom
plénitude et nostalgie
dans l’incertitude de ce qui est fumée
de ce qui est neige ou brume
de ce qui est l’enfance de ce qui ne l’est plus
tout semble s’engouffrer
flocons feu fumée châtaignes bogues et branches
pommes de terre dans l’aluminium
comme une offrande à l’entrée des enfers
deux êtres proches alimentant le foyer
ouvrent la porte unis et déjà distincts
de part et d’autre de la couleur vibrante et chaude
luttant sous le brouillard