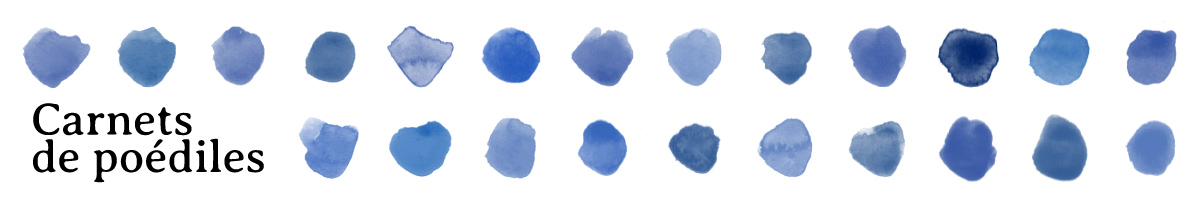C’est le titre même du recueil, Les Ruines de Paris, qui me fait plonger dans les textes, ce recueil est de Jacques Réda. Quand je lis le titre du livre des ruines, sur l’un des comptoirs de je ne sais quelle librairie, je fais aussitôt le lien avec celles de Troie que rechercha tant Schliemann bien après le désastre homérique – l’un des désastres de la ville –, et je m’amuse ou m’enchante de cette audace du poète contemporain, dont je découvre alors le nom, voir Paris en ruine, comme une autre ville illustre autrefois, en de tout autres lieux, ville dont la chute avait suscité un très grand poème, colère, et guerre, destruction, assujettissement, deuil. À quel moment ai-je pensé qu’il s’agissait un peu d’autre chose, voir Paris par ses ruines déjà là, ses recoins dédaignés, ses murs ingrats, leurs lambeaux d’affiches, des papiers salis traînant ici ou là, ses voies disgraciées – mais pas seulement bien sûr –, le voir aussi à travers certaines nuances de ses cieux, ses lumières, ce qui est tout aussi audacieux ? À quel moment ? Sans doute dès que j’ai plongé dans les textes. Mais à la seule lecture du titre, l’audace ressentie me plaisait. Et non par goût de la province, non, ou de la vie de province, non, mais parce qu’il y avait eu – et sans doute il y avait encore1 – un indigeste discours de célébration de Paris, discours sans nuance – lequel s’accrochait alors à la construction de la tour Maine-Montparnasse –, et produisait une bête glorification de cette haute tour sombre qu’un journal satirique avait désignée comme le « gri-gri de Chirac », formule qui me plaisait bien plus et mieux que le nom officiel donné au « bildingue »…
J’ai dû ouvrir le recueil aussitôt que le titre m’a ainsi attiré l’œil, sur le comptoir, et voir alors que, s’agissant de poèmes en prose, le recueil faisait signe aussi du côté de certain baudelairien « Spleen de Paris ». Ce qui induisait une double origine poétique, lointaine et plus récente, noble et plus teintée de trivialité, combinaison maligne ou croisement très savant pour des descriptions de lieux abîmés, défaits, ruinés – ce qui m’a convaincu d’acheter aussitôt le volume.
Je ne saurais dire exactement à quelle date j’ai fait cet achat et la lecture qui a suivi, le recueil date de 1977, mais mon achat est plus récent…
*
Et puis je me souviens tout à coup très bien d’avoir pensé à Jacques Réda à Meknès du Maroc, une fois où je me promenais seul dans le quartier de l’Agdal, autour du grand bassin construit par le sultan contemporain de Louis XIV qui y faisait puiser l’eau pour les jardins de son palais – et plus précisément je me trouvais à une table du « petit café maure », je veux dire traditionnel, qui existait alors sur un étage de l’une des constructions proches du grand bassin. Je me disais qu’il y avait aussi à Meknès de quoi faire un beau recueil de descriptions, murs délavés, griffés, petites rues tournant soudain au cœur de la médina, poussières, déchets abandonnés, en allant aussi jusqu’à Volubilis, Oualili, vraie ville en ruine, toute proche, magnifique dans son décor dénudé. Je me demandais si Jacques Réda accepterait de venir voir Meknès. Je ne sais quelle suite j’ai donnée à cette rêverie – ai-je au moins écrit une lettre ? En tout cas si j’en ai parlé à quelques collègues bien mieux dans la place que je ne l’étais puisque j’arrivais juste dans cette École et normale et supérieure d’un quartier périphérique, je vois tout à coup quelle figure de refus ils ont pu faire, la si assurée « Madone des sleepings » et Gérard qui irait plus tard dans les Pyrénées, les deux dont je retrouve le visage et le nom (le surnom), car ils ne devaient pas connaître ce recueil relativement récent dont je m’étais entiché (et ce n’est pas mépris que de dire cela, ils lisaient autre chose, voilà tout).
Ces souvenirs en tout cas datent à coup sûr ma lecture de ce moment. J’ai sans doute acheté Les Ruines de Paris le premier été qui a suivi notre arrivée au Maroc, l’été de 1986, et j’ai dû le lire dans la foulée et à l’automne de cette année-là.
*
Cette rêverie meknassie montre aussi que j’étais alors loin de bien connaître un poète qui est certes allé Hors les murs, qui a célébré L’Herbe des talus sur l’un des bords de la Loire, qui a évoqué Lunéville de Lorraine où il est né, dans le magnifique récit autobiographique Aller aux mirabelles, qui est même allé « au diable », mais qui est loin d’avoir transporté sa manie descriptive en tous lieux – même s’il a fait Un voyage aux sources de la Seine (que je ne connais pas), s’il s’est payé une place au poulailler de l’opéra de Vienne (Autriche), s’il a tenté de grimper le flanc du Ventoux, ou s’il est allé « à Elisabethville », à la condition que cette ville soit celle du New Jersey (USA) plutôt que la commune des Yvelines à proximité de Flins et de ses usines Renault… Mais il est bien évident que je ne pouvais connaître en 1986 des textes qui ont paru quelque temps après (je parle de celui qui porte sur les sources de la Seine et du récit autobiographique, pas de celui qui concerne Elisabethville que je n’ai pas lu).
Mais il est tout à fait possible que, emporté par l’idée du croisement des projets et influences qui m’a immédiatement saisi et enchanté à la lecture du titre, je n’aie pas bien compris le propos de Réda dans ses Ruines de Paris au moment de ma première incursion dans le recueil. Car j’ai été pris aussitôt par les proses, leurs précisions et leurs tons, en passant peut-être les trois ou quatre poèmes en italiques, sans connaître les recueils qui avaient précédé. Et j’ai aimé ces figures de l’humaine condition, le piéton, le vélocipédiste, le flâneur, le passant, le voyageur, qui vont le plus souvent par des voies de traverse, ou communes, ou en diagonale, et qui aperçoivent, contemplent, ressentent tout ce détail des lieux et des jours dans leur banalité… Qui les ressentent comme ce qui fait la vie même dans son tissage permanent le plus ténu et qu’on n’a pas le temps, non, mais le tort, oui ! de ne pas remarquer vraiment, au moins un instant.
Détails locaux et quotidiens qu’on inscrit machinalement pour très peu de temps dans une mémoire qui va bientôt les remplacer par d’autres, vu qu’on n’en retient, n’en fait rien.
Et les figures, piéton, flâneur, vélocipédiste, tous acteurs d’une vie sans projet autre que la contemplation ou l’immédiate remémoration de son propre passage dans un monde au ras de terre, en des lumières, des atmosphères changeantes, je les aimais beaucoup. Comme j’aimais aussi, dans une tout autre perspective, les angles de vue à partir de ce « je » qui se déplace un peu au hasard et regarde uniquement depuis le point où il se trouve, mais avec sérieux, engagement.
On accède au pont de fer très noir par deux escaliers qui se rejoignent. J’emprunte celui de gauche et, à peine au sommet, ma tête cogne contre un bec de gaz. Tout le ciel gris et bleu trempé se remplit de tours2…
Il est vrai aussi que lire tel poème sur le croisement d’un livreur à vélo sur l’avenue de Suffren embouteillée en prenant son attaque « Car finalement nous ne sommes […] que de passage et pour très peu de temps sur terre3 » seulement comme un propos aussi anodin que de parler de la pluie ou du beau temps, lire ces propos du livreur seulement comme une amorce de banale discussion sur le temps qu’il fait, même pas calendaire, est sans doute une erreur, une erreur de taille. Même si le discours existentiel est quand même minimisé dans la description qui s’ensuit et s’écarte un peu au-delà de ce cycliste-là.
Mais je lisais ces poèmes pour moi, dans la perspective de la combinaison des titres, l’antique et le plus récent, qui m’avait happé, et à travers ce qu’ils produisaient en moi de plaisirs, celui du déroulement des phrases où un adverbe un peu long venait parfois couper un rythme ou le déstabiliser, celui des constructions composées posément pour aboutir à la description rapide d’un élément ténu, cet autre encore, fait d’étonnement et d’admiration, quand je découvrais des notations sur le degré d’humidité ou les nuances fluctuantes de couleur dans les différents cieux parisiens, - en même temps que je me repaissais des vues sur des espaces et coins plus ou moins désertés, sur des femmes venant arroser d’un peu d’eau les pots à fleurs de leurs balcons, sur un envol soudain de papiers plus ou moins gras, et sur quelques autres espaces, des silos, des gares, des lieux avec poussière, quelques vraies ruines aussi bien évidemment.
Les descriptions touchaient en moi des souvenirs d’images soudaines de rues ou façades, ou fenêtres et portails, à peine notées et quasiment oubliées, tout ce qui contente un œil aimant passablement la photographie urbaine et ses prises, ou un esprit songeant que tout cela qui est en dehors de tout discours, que la prolifération incessante des discours autorisés met hors de la vue, est aussi l’espace de nos vies contemporaines.
Décor trop souvent négligé !
Au beau milieu restent ces hangars dont manquent presque toutes les vitres. On distingue au travers le ciel qui traîne le long des rails. Un très petit wagon de marchandises descend seul une rampe. Il est rouge brique…4
*
De cette première lecture, heureuse, s’ensuivent quatre pistes – en cela le recueil marque ma vie de ce moment. Et la première des suites n’est pas très sérieuse, c’est juste un peu plus qu’une songerie, et elle se trouve très vite interrompue : je ne fais rien (ou trop peu ?) pour que Jacques Réda vienne à Meknès.
La deuxième est très simple, qui me conduit de Paris à sa périphérie tout autant décrite Hors les murs, à tous les lieux poétiquement mais précisément recensés dans L’herbe des talus, à la dégustation du récit sur les mirabelles, aux Châteaux des courants d’air, à un certain Retour au calme. Qui me conduit aussi en arrière, vers les courts poèmes d’Amen, que j’ai bien moins aimés que les proses descriptives du moment de ma découverte de Réda, pour le caractère vague, par trop énigmatique de leur propos, et la sensation de désespérance dont on ne comprend pas aisément l’origine. La deuxième piste est donc tout simplement celle des lectures qui ont suivi, que je poursuis par intervalle pendant un certain temps, que j’interromps plus tard quand j’ai l’impression d’un certain ressassement, quand je suis pris aussi par mon inscription dans un projet collectif qui change la donne et me fait remonter une pente. Car ces lectures accompagnent les déplacements que nous faisons, de Meknès à Maisons-Laffitte d’où je rejoins trois ou quatre fois la semaine le collège de Houilles (aïe !) et une fois la semaine l’université Vincennes à Saint-Denis (ouille !), avant que nous nous repliions sur Orléans d’où je gagne régulièrement pour trois jours Bourges, son école normale, ses rues anciennes, avant l’arrivée sur Grenoble, ses avenues alors sans arbres dans la chaleur dure du mois d’août. Un peu plus tard, une militante qui en sait assez à sa manière sur la poésie s’étonne de me voir aimer un tel poète (certes pas militant du tout, sauf pour la poésie « qui vient à pas léger »). Viendra le jour où une amateure-ou-trice de poésie sera surprise aussi que je ne préfère pas, à Réda, André du Bouchet (dont j’ai l’impression qu’il écrit des poèmes totalement abstraits en deux-trois mots entremêlés de silences) ou Jaccottet à tout le moins (il me faudrait parler aussi de Jaccottet ? J’en sais si peu… Sinon le très grand plaisir attrapé à quelques textes… « Beauregard » ? À tout le moins « Beauregard », oui…).
Concomitante de la poursuite des lectures, la troisième suite est celle de l’imitation, plutôt que de l’écriture, ou de l’inspiration. Car nommé, à ma demande (le plus étonnant quand même !) enseignant à l’École normale de Bourges, je suis soudain dans un décor et surtout une situation si étranges, si au-dehors de tout ce que j’avais envisagé de ma vie, que l’écriture de quelques textes de prose5 me donne une certaine façon de m’y retrouver, de m’y faire une place un peu de côté, un peu de biais, comme à la manière de Réda, et me procure également ensuite un peu de réconfort puisque Thierry Bouchard, sans que je le rencontre, accepte de publier ces textes dans sa belle revue orléanaise de Théodore Balmoral.
La quatrième, un peu plus tard, est une première forme d’écriture scolaire de lectures, forme traditionnelle puisque s’y trouvaient des commentaires, mais forme en partie renouvelée puisque la première étape que j’avais décidé de prendre et d’exemplifier (comme on dit dans les colloques) était cette nouvelle manière de lire qu’une inspectrice générale avait été chargée de concocter pour un abandon concerté de l’ancienne « explication de texte »… Cette quatrième piste ne repose pas seulement sur Jacques Réda dont je retiendrai et commenterai deux poèmes dans le volume publié ensuite, car, ayant su qu’il dirigeait alors la Nouvelle revue française, j’avais décidé de repérer dans chaque numéro lu en bibliothèque, celle d’Orléans, ses parquets, ses boiseries, des poèmes contemporains qu’on pouvait intégrer dans un volume à orientation didactique (ou pédagogique ?) qui tiendrait aussi de l’anthologie pour un moment particulier, une dizaine d’années, 1980-1990.
C’est pour suivre cette quatrième piste que je lus avec un grand émerveillement mes premiers textes de Jaccottet revenant en arrière pour la beauté du nom d’un village (Beauregard, oui) ou s’émerveillant des arabesques d’un vol d’étourneaux ; de nouveaux poèmes de Guillevic, bien plus longs que tous ceux que je connaissais déjà ; que je découvris avec un étonnement admiratif Lorand Gaspar devant le désert ; avec un grand intérêt Philippe Delaveau quêtant la grâce ; avec un certain amusement et parfois un peu d’ennui Jude Stéfan et ses amours très voluptueux et bancals ou grimaçants, etc.
Cette quatrième piste me permit aussi de bien chaudes complicités dans le travail avec une collègue qui passa à Grenoble, en repartit et dont je n’ai plus de nouvelles, Mic Gewinner (hello, Mic !) ; avec Évelyne Bedoin qui, depuis, a fait son chemin du côté de Strasbourg tout en revenant tous les ans du côté de Sète (pas cette année, hélas !) ; avec ceux qui sont devenus mes amis, Françoise et Patrick Demougin ; et avec celle qui alors, avait ajouté la charge de directrice des publications au CRDP de Grenoble à ses activités de formatrice et d’autrice pour la jeunesse, Nicole Schneegans6.
Heureuse lecture alors que celle de Jacques Réda, au-delà des plaisirs immédiats le nez dans les pages, l’esprit vagabond mais dans les rythmes. Pour les découvertes qu’elle m’a fait faire, et pour cette série de suites jusqu’aux amitiés… Mais lecture interrompue pour d’autres dans d’autres directions, lecture un peu oubliée.
Et lecture vers laquelle je suis revenu momentanément, en remettant les yeux dans quelques-uns des recueils sur la colonne consacrée à la poésie de l’une des bibliothèques de notre appartement (alors il s’agit de relecture ? Ah voilà donc à quoi sert d’avoir gardé tous ces livres ! Comme si cet écrit de souvenirs visait à réunir autrement quelques livres, ces recueils, qui, un jour, s’envoleront des étagères vers on ne sait quelle destination…).