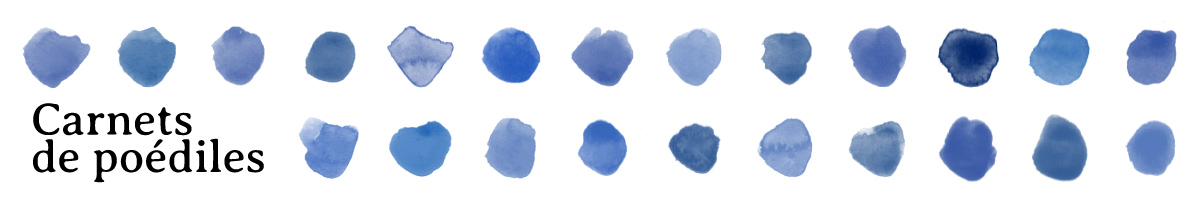Avant d’être des sens, les mots sont des sons, des images.
Avant d’être expulsé dans l’air et la lumière, avant de voir le ciel et le soleil, et le visage immense penché sur moi comme un second soleil, avant de voir, de toucher, de sentir, avant de naître, avant de vivre, j’avais déjà, comme tous mes frères et sœurs humains, vécu neuf mois.
Lové dans le repli d’une poche chaude et liquide, au fond d’une grotte de résonance et d’ombre, j’avais déjà vécu dix lunes d’une nuit sonore, d’une musique pure.
Avant de naître, des bribes du monde externe, sous forme d’échos vagues et lointains, m’avaient rejoint dans la pénombre humide de mon royaume, entrant en moi par les oreilles, me perfusant. Avant d’être parachuté de ce refuge sur Terre, avant d’ouvrir les yeux et de respirer, pour la toute première fois, sous le néon unique du ciel, je l’entendais déjà.
Avant de lire, d’écrire, de converser, de compter, calculer, commercer, avant de parler, de penser, je le voyais, le regardais, en absorbant, par les pupilles, à hauteur des genoux adultes, des fougères, le moindre centimètre carré.
Longtemps, pour moi, les mots écrits et entendus furent des images, des sons. Longtemps lettres et paroles furent des signes, des dessins ou des voix, traits, traces, lignes, courbes, notes, timbres, rythmes, mélodies.
Avant toute autre chose, j’ai entendu et écouté, vu, regardé.
Avant tout, j’ai vibré.
Au commencement étaient le son, l’image, leurs infinies déclinaisons.
L’Homme est un être, d’abord, de sensations.
Sonne ainsi l’heure de régresser, de tout remettre à jour, d’enfin rentrer chez soi, à la maison natale, allez, en arrière toute !
Je relis l’Odyssée.
Enfin parvenu à Ithaque après dix ans d’errance sur les flots et les îles de Méditerranée, Ulysse, l’homme aux mille ruses, ôte son armure et se drape de guenilles, déguisé en vieux mendiant pour ne pas se faire reconnaître de la cohorte des prétendants qui ont, en son absence, assiégé son palais et tenté sans cesse de séduire son épouse, la fidèle Pénélope. Devant la porte de la demeure quittée il y a vingt ans, sur le seuil même de son bonheur, alors qu’il le franchit, foule l’espace de sa cour, de son sang, s’avance parmi les siens, nulle servante, nul esclave, nul noble, nul soldat, pas même sa femme ni Télémaque, leur fils, ne perce le stratagème, ne lève le voile, ne reconnaît le roi d’Ithaque, vainqueur, à son retour de Troie.
Personne si ce n’est Argos… son chien fidèle !
Si le texte, dans une traduction publiée1, dit que « le chien reconnut Ulysse en l’homme qui approchait », le texte grec dit, plutôt, que « le chien flaira Ulysse en l’homme qui approchait », que « le chien pensa Ulysse ».
Ou quand la première occurrence du verbe « penser » dans la littérature occidentale …signifie « flairer »
Aux antipodes de la vision occidentale depuis Descartes, la pensée n'a pas toujours été entendue comme exclusivement rationnelle, indépendante du corps, désincarnée. Prenant sa source au cœur du corps et de ses sensations, montant du plus profond du ventre comme du cœur, elle est le propre de l’animal, qu’il soit doté ou dépourvu de raison.
Avant de raisonner, de construire, d’élaborer, de s’éloigner, de perdre lentement de vue, on sent, respire, poursuit des pistes, le nez à même le sol – à même la terre, à même la page – avance et vagabonde, se fourvoie et revient, renifle, retrouve une trace, la suit, la flaire encore, sans cesse, se rapproche, trouve et reconnaît.
Avant de penser assis en bibliothèque, sous cloche, comme de nouveaux chiens d’Ulysse, on erre et cherche à l’air libre, en flairant.
Si la lecture d’un texte devrait toujours ouvrir une scène où le lecteur, le texte et le contexte se rencontrent et échangent, c’est que son réseau de significations, son sens, loin d’émaner seulement de son auteur et de ses exégètes qui l’auraient consigné pour toute l’éternité dans le ciel pur des formes académiques, loin de pleuvoir de cette seule source, loin de tomber d’ailleurs, s’érige plutôt, s’élève à partir de la terre, sur la terre, à même les pages, leur grain, leur chorégraphie, leur odeur, à même nos expériences, nos souvenirs, de vie, de livres.
Une telle vision de la lecture conçue comme processus d’interprétations collectives où le sens reste ancré à l’expérience humaine et littéraire des différents lecteurs, si elle oblige de faire le deuil de l’universalité et de la nécessité propres à la vérité, ne fraie pas moins les champs de la validité, cet autre et noble nom de la « justesse ».
Lire un texte, tenter de le comprendre, d’appréhender son sens, c’est d’abord, à mes yeux, avant tout, y plonger soi et en émerger autre, gorgé de sensations, d’impressions, d’émotions, transformé. Plonger dans une immensité inépuisable en repêchant les grains, les coquillages, les algues, tous les mouvements et menues marques dont cet infini m’a empreint.
Lire comme on flaire un sens, des sens, suivant des pistes, se lançant dans une quête, une enquête, tout d’abord, perceptive.
Et d’autant plus peut-être, sans doute, sans aucun doute, quand il s’agit de poésie, dans la mesure où notre hôtesse, éternellement insaisissable, éternellement présente, reste avant tout, fidèle à son étymologie grecque (poesis → poein = « faire », « fabriquer », comme le potier façonne l’amphore) la création artisanale d’un monde.
Monde total, d’abord sonore (lyre des aèdes, harpe des troubadours, « De la musique avant toute chose » de Paul et trompette de Boris, guitare de Brel ou de Brassens…) et visuel (Ut pictura poesis d’Horace), mais aussi olfactif, tactile et gustatif.
Monde total dont le sens, d’abord, tombe sous les sens.
Primum vivere, deinde philosophari, disaient les Latins : vivre d’abord, ensuite philosopher.
Sentir d’abord, ensuite analyser, oserais-je traduire, élargissant le sens du vieil adage en le projetant, comme dans un jeu d’échos, de ricochets ou de reflets, du vivre au lire, de la vie à la poésie.
Ainsi, comme nous y invite le poète de « Romances sans paroles », commencer par sentir, entendre, respirer, voir, vibrer :
De la musique avant toute chose
[…]
Prends l’éloquence et tords-lui son cou !
[…]
Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym…
Et tout le reste est littérature.
Paul Verlaine, « Jadis et Naguère », 1885
Durant les 12 ans de mon enseignement du français et de la philosophie à des élèves de 15-20 ans engagés dans une formation leur délivrant, en 4 ans, une maturité gymnasiale ou un baccalauréat français (Secondaire II), j’ai conçu et conduit chaque année, pour chaque degré des deux filières, des séquences d’enseignement-apprentissage de la poésie qui procèdent par cette approche, cette immersion, sensible.
Si les programmes de la maturité et du baccalauréat m’y poussaient sans m’y obliger pour autant, mon amour de la poésie, en tant que lecteur déjà et, humblement, en tant qu’auteur, n’aurait pas pu – ne pourrait toujours pas – ensevelir ce continent, cet univers, cette voix, dérober à la vue et à l’oreille de mes élèves de telles pépites, les amputer de tels trésors.
« L’AMOUR LA POÉSIE : Sonnets d’amour de Pierre de Ronsard » est ainsi une séquence qui, en s’inspirant de la figure d’Ulysse vagabondant dix ans sur les terres et les mers pour retrouver Ithaque, propose une immersion dans l’univers océanique de la poésie, une errance amoureuse qui, à cheval sur les âges, les courants et les arts, orientée par la boussole des sens, regagne le port des Sonnets d’amour du chef de file de la Pléiade.
Une odyssée de 12 périodes de 45 minutes conduite, de fin novembre à fin janvier 2024, avec un équipage sympathique, curieux et engagé. Composé de 10 navigateurs en herbe entre 15 et 16 ans (6 garçons pour 4 filles), le groupe déploie une dynamique vertueuse aussi bien au niveau des comportements que des apprentissages, qu’il s’agisse de tâches individuelles, en binômes comme en groupes.
Si l’une des élèves, souffrant de troubles de dyslexie-dysorthographie pour la compensation desquels elle bénéficie d’aménagements temporels et technologiques à l’occasion des évaluations écrites, est particulièrement intéressée par les arts visuels, le groupe, relativement homogène, rassemble des personnalités portées plutôt, par leurs affinités et par leurs performances, vers les mathématiques et les sciences. Un des élèves, d’ailleurs, doté de compétences exceptionnelles en mathématiques, suit à l’EPFL, chaque mercredi après-midi, en parallèle à sa formation gymnasiale, les fameux cours Euler.
Néanmoins, à ma grande surprise depuis le début de l’année, et pour ma très grande joie, tous les élèves se montrent curieux, intéressés, intéressants, ne rechignant jamais à se jeter à l’eau, quittant avec plaisir le continent scientifique pour naviguer vers les lointains rivages de la littérature, voguer vers ses confins, les îles étranges et vaporeuses de l’archipel de Poésie.
Au bout du monde et de l’esprit, tout au fond de l’énigme de notre condition humaine, les pistes que fraient la poésie et les mathématiques – physique, cosmologie, astronomie incluses – tout étrangères qu’elles sont, ne finissent-elles pas pourtant par converger et se rejoindre, par se ressembler étroitement ?
Si l’un des matelots du navire « 1ère B », par ses connaissances mythologiques gréco-romaines dépassant celles d’un pair ayant choisi l’option latin, incarne bel et bien cette convergence, cette transversalité, je tiens encore à préciser, en guise de dernière touche à cette esquisse de l’équipage, que tous ses membres consacrent deux plages de 15 minutes hebdomadaires à l’écriture créative comme à des lectures personnelles.
Avant d’embarquer et de découvrir quatre des cinq activités de la séquence2 qui mettent spécifiquement en œuvre une approche sensible de la poésie – écriture d’un poème personnel à partir d’une image ; poème dialogué dans les marges3 (« Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle ») ; poème-fantôme4 (« idem ») ; création d’une carte du Pays de Tendre 3.05 ; recueil à quatre mains6 (« Mon Ronsard »), redessinons la carte des grandes étapes, trajectoires et escales, de ce voyage d’amour, et de poésie fraîche.
Comme Ulysse qui, après dix ans de tours et de détours aventureux sur le pourtour méditerranéen, retrouve enfin Ithaque, son épouse, Pénélope, et leur fils, Télémaque, cette séquence d’enseignement-apprentissage se propose d’aborder, par un périple perceptif zigzaguant à travers les siècles et les arts, l’univers poétique et, plus particulièrement, la poésie amoureuse de Ronsard.
Comme le poème, par sa nature trouée, vaporeuse, libre, insaisissable et, en même temps, très ordonnée, rythmée, délimitée et contraignante, incarne parfaitement les deux lectures – jeu de rôle (playing) et jeu de règles (game) – développées par Picard7, ce dispositif donne la part belle à l’approche sensible et à l’induction tout en les complétant de mises à distance critiques et interprétatives, oscillant dans son déroulé même entre expérience sensible et lecture littéraire, cédant tour à tour la parole au sujet-lecteur-scripteur et aux droits du texte.
Ainsi, après une première période d’introduction au thème de l’amour et à ses traitements dans les arts visuels, tout d’abord par une description sensible de quatre tableaux (La Naissance de Vénus de Botticelli, Les Amoureux aux marguerites de Chagall, Le Baiser de Klimt et Les Amants de Magritte), d’une photographie (Le Baiser de l’hôtel de ville de Doisneau) et d’une sculpture (La Valse de Claudel), puis par l’écriture d’un poème personnel librement inspiré par l’une de ces images, les élèves étaient alors invités, au cours des deuxième et troisième périodes, à décrire, puis à analyser, d’une part, des allégories picturales de la poésie et des cinq sens (La Poésie de François-André Vincent et les cinq allégories de Brueghel et Rubens) et, de l’autre, à déchiffrer et reconstruire le sens de Flèche saignante, calligramme amoureux d’Apollinaire pour Lou.
Loin de naviguer dans l’azur, ce premier quart de l’odyssée avait pour double but de souligner la permanence du thème amoureux dans l’histoire des arts et de la littérature et de mettre en lumière les rapports intimes que la poésie tisse avec les arts visuels et, par excellence, la peinture.
Mais si les mots, avant d’être des sens, sont des images, s’ils recomposent, par le jeu poétique, les lignes et les mouvements, les formes, les ombres et les couleurs de la peinture d’un monde en lui prêtant une voix qui l’anime, le fait vivre, les mots, en tant que sons, rythmes, mélodies, empruntent aussi, comme d’une source privilégiée, les voies et les ressorts de la musique. C’est dans cette perspective que notre errance vers les Sonnets d’amour de Ronsard vire de bord, ouvrant une deuxième digression faisant passer notre équipage, d’abord, du calligramme d’Apollinaire à la chanson de Brassens, Heureux qui comme Ulysse, puis, de celle-ci au poème-source de Du Bellay, afin de l’initier, au-delà des liens que tissent la poésie et la musique, à la question cruciale de la réécriture et de ses deux principes d’imitation et de variation.
Après plusieurs écoutes sensibles consacrées à faire émerger les sensations et les impressions que la réécriture du poème renaissant fait naître dans l’esprit des élèves, un travail en groupes sur le texte même de la chanson du poète à la pipe, en soulignant les thèmes du voyage, de l’exil, de la nature et de la nostalgie, de la patrie perdue et du désir de retrouver enfin « le pays des vertes années », ouvre pour notre flotte une voie royale du chansonnier du 20ème siècle au second rossignol de la Pléiade. Revenus à bon port armés ou aguerris par les échos contemporains du poème de la Renaissance, invités à recomposer d’abord comme à tâtons, en s’appuyant sur le schéma de rimes propre au sonnet, le poème volontairement désossé de Du Bellay, les élèves étaient alors engagés à son étude individuelle par commentaire guidé avant de comparer, en groupes, ces deux œuvres séparées de quatre siècles, ces deux voix à la fois mêmes et autres, inséparables.
Initiés aux principes d’imitation et de variation à l’œuvre dans toute réécriture, nous voici parvenus, au milieu de notre odyssée, sur le seuil même des Sonnets d’amour de Ronsard. Poussant la porte par l’écoute du poème « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle » chanté en 1941 par Lucienne Boyer, les élèves avaient alors pour tâche d’appréhender, en binômes, ce premier sonnet de Ronsard par l’approche sensible du poème dialogué dans les marges : après avoir lu le poème attentivement, chaque membre des duos l’annotait d’abord, dans les marges supérieures, inférieures et latérales, de questions, de remarques et de commentaires libres auxquels son camarade, dans une deuxième phase, répondait, avant que, finalement réunis autour des deux versions du même poème diversement annoté, les deux élèves découvrent leurs résultats et les discutent en croisant leur regard.
Afin de multiplier les points de vue sur ce premier sonnet de Ronsard et d’en approfondir la compréhension individuelle par les ressources de l’interprétation collective, le poème dialogué dans les marges s’est ensuite étendu, transformé en un poème résonnant en chœur où les binômes, réunis en plénum, présentaient, en les expliquant, leurs découvertes, leurs certitudes, leurs doutes, interrogeant leurs pairs sur les zones floues du texte, sur tous ses éléments encore opaques. Une fois posé ce socle d’interprétation collective de « Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle », les élèves avaient encore pour tâche d’en écrire le poème-fantôme : retournant la feuille où le sonnet était inscrit, sur son verso complètement vierge, en ne recourant qu’à la mémoire didactique collective et, surtout, aux empreintes sensibles laissées en eux par sa lecture, ils écrivaient alors un poème condensant, comme dans un creuset, toutes les traces, reflets, échos, vestiges qu’ils avaient pu en conserver.
Pour marquer une prise de recul, ou de hauteur, critique et objective, ce troisième quart de notre périple poético-perceptif s’est achevé par une phase de transmission, sous forme dialoguée, des spécificités historiques, techniques, religieuses, philosophiques et esthétiques de la Renaissance, de l’Humanisme et de la Pléiade (imprimerie, Réforme, guerre des religions, grandes découvertes géographiques et scientifiques, héliocentrisme et retour aux modèles littéraires antiques), elle-même suivie, pour affiner leur familiarité avec l’univers poétique de Ronsard, du commentaire guidé d’un deuxième sonnet de sa main : « Sur la mort de Marie ».
Pour l’équipage lesté de toutes ces expériences et apprentissages partagés, sonnerait bientôt l’heure de se séparer pour que chacun, monté à bord de son embarcation suivant sa propre piste, parcoure de lui-même les dernières encâblures qui l’éloignaient encore de son Ithaque : la création d’un recueil à quatre mains (« Mon Ronsard »). Ne restait plus alors qu’à leur présenter la Carte du Pays de Tendre8 afin que les élèves se l’approprient et la transforment, inventant leur version adaptée au trajet amoureux personnel que leur recueil redessinera et l’intégrant dans leur postface.
Une première fois, la sirène retentit.
« Votre recueil devra compter d’abord une page de titre de votre choix (« Mon Ronsard », « Nouvel Amour », « Eros 2.0 »…), une préface dans laquelle vous présenterez votre rapport à la poésie en général, votre expérience particulière de celle de Ronsard ainsi que les intentions qui ont guidé la sélection de vos sonnets, puis vos morceaux choisis (six pièces au minimum) suivis d’un poème de votre cru qui, en guise de postface, témoigne de votre voyage dans les Sonnets d’amour, avant l’annexe, enfin, de votre Carte du Pays de Tendre revisitée. Vous avez des questions ? »
Une deuxième alarme résonne sur le rivage.
« Ai-je répondu, Nathan, à votre question ? Tous vos doutes, Aloïs, Elodie, Emil, Garance, William, Alexandre, Max, Lola, Elizabeth, sont-ils bel et bien dissipés ? »
Dernier signal, les corps embarquent, les ancres s’élèvent, tous les poignets moulinent déjà, et je regarde, déjà, les dix voiles qui s’éloignent9.
Si ma séquence a poursuivi les pistes d’un cheminement inductif, si ce travail s’est appuyé sur l’expérience sensible en empruntant des tours et des détours, en tâtonnant, errant, c’est qu’à mes yeux, la poésie, contrairement aux champs de la physique, de la chimie ou de la statistique, échappe à toute saisie certaine, objective, absolue, à toute définition, déjà, à toute résolution définitive.
Un tel état de fait relève de sa nature, comme des objets qu’elle se propose, qui, elle comme eux, ne peuvent s’extraire de l’historicité d’un espace et d’un temps, ne peuvent se délester du « paramètre » humain, ou de sa patte, ne peuvent faire fi de cet impondérable imprévisible.
Et heureusement !
Partout, et d’autant plus dans le cadre humaniste que toutes les formes d’éducation se devraient de préserver et de défendre coûte que coûte, une telle réalité est loin, d’ailleurs, d’être un malheur, ou un mauvais présage, comme le rappelle, avec humour et poésie, cette perle de l’aphoriste roumain :
« Être objectif, c’est traiter l’autre comme on traite un objet, un macchabée, c’est se comporter à son égard en croque-mort. »10