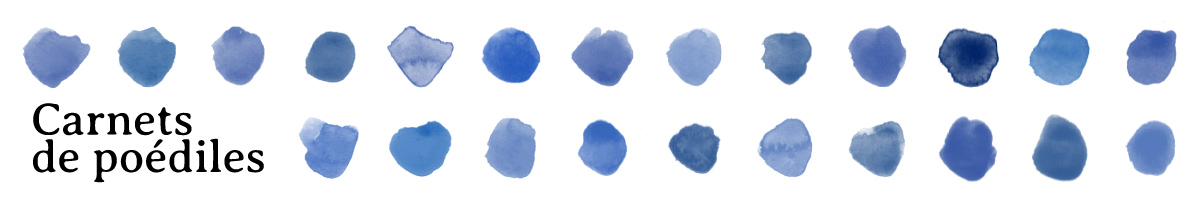Introduction
Depuis 2014 pour l’enseignement de qualification (technique et professionnel) et 2018 pour celui de transition (général et technologique), les pratiques d’enseignement-apprentissage du français langue première (français L1) pour les dernières années du niveau secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) sont régies par un prescrit fondé sur sept unités d’acquis d’apprentissage (UAA). Parmi ces UAA, deux sont particulièrement concernées par les savoirs littéraires : « S’inscrire dans une œuvre culturelle » (UAA 5) et « Relater des expériences culturelles » (UAA 6). Ce prescrit légal a été pris en considération dans neuf collections de manuels scolaires, dont l’utilisation par les enseignant·e·s1 de français L1 exerçant dans les dernières années du secondaire s’avère en augmentation (Simard et al., 2019, p. 177). Située dans ce contexte précis, la réflexion sur les pratiques d’enseignement-apprentissage liées à la poésie dont rend compte le présent article sera construite sur une démarche « synchronique » et « descriptive » (Simard et al., 2019, p. 390) visant à susciter le questionnement, et ce dans une optique d’amélioration des pratiques didactiques actuelles.
Dans un premier temps, nous rendrons compte de l’analyse d’une sélection de six séquences dans des ouvrages d’éditeurs différents, à partir de plusieurs questions de recherche ; cette analyse sera étayée par des références au prescrit légal récent. Nos résultats seront discutés grâce à des travaux en didactique de la littérature et nous les mettrons en regard de ceux issus d’autres recherches (Brillant Rannou et Boutevin, 2018, 2020 ; Brunel, 2016 ; Émery-Bruneau, 2018, 2020 ; etc.). Le but est de décrire l’enseignement-apprentissage de la poésie et de la lecture de poèmes dans des manuels de français L1 en FWB. Dans un second temps, avec un objectif relevant de la didactique professionnelle, face à plusieurs constats tirés de nos analyses et qui semblent faire consensus dans le champ scientifique francophone, nous présenterons un dispositif destiné à de futur·e·s enseignant·e·s de français L1 pour le début du niveau secondaire : le « Poetic Lab », mis en œuvre à la Haute École Charlemagne (Liège) par Charlyne Audin. Ce laboratoire d’écriture créative et de réflexion linguistique, coanimé par des poètes et poétesses ainsi que par des didacticien·ne·s, place la langue poétique au centre des préoccupations linguistiques des étudiant·e·s en cours de formation initiale.
1. Poésie et poèmes dans les manuels scolaires de français L1 : quelques constats
1.1. Considérations méthodologiques préalables
Notre corpus est constitué de manuels scolaires, entendus ici au sens d’ouvrages placés entre les mains des élèves pour servir l’enseignement-apprentissage d’une ou de plusieurs dimensions de la discipline « français L1 » dans le secondaire. Ces ouvrages concernent uniquement ce qu’on appelle en FWB la section de transition (enseignement général ou technologique qui prépare à l’enseignement supérieur), car seules les instructions officielles pour cette section (au contraire de celles pour la section de qualification) comportent des prescriptions relatives aux savoirs littéraires (et aux corpus, dans la mesure où des courants sont imposés pour certaines années). Ces manuels présentent plusieurs traits communs :
-
ils ont été publiés par des maisons d’édition belges : Averbode-Érasme, Plantyn et Van In ;
-
ils visent les quatre dernières années du secondaire (des élèves âgé·e·s de 15 à 18 ans) ;
-
ils ont été publiés après 2018, année de parution du nouveau référentiel de compétences.
Étant donné la problématique qui est la nôtre, nous avons sélectionné au sein de ces manuels six « séquences » (les manuels s’inspirent souvent du modèle de Dolz et Schneuwly, 2016, p. 91-114) qui traitent de la poésie et/ou qui amènent les élèves à lire des poèmes :
-
Connexion Français 3 (Marion, 2018a, 2018b) : séquence « Vers à soi » ;
-
Connexion Français 4 (Marion, 2019a, 2019b) : séquence « Diapoésie romantique » ;
-
Connexion Français 5 (Marion, 2020) : séquence « Absolus, mais maudits ! » ;
-
Parcours & moi Sup’ 3e degré. La poésie : du baroque au surréalisme (Cox et Jadot, 2021) ;
-
Parcours & moi Sup’ 4. Le romantisme (Bloemen et al., 20202) ;
-
Point-virgule 4 (Kinet et al., 2019a, 2019b) : séquence « Quand les cœurs s’épanchent… ».
L’analyse sera fondée sur quatre critères, correspondant à quatre questions de recherche :
-
les corpus littéraires : quels sont les poèmes que les élèves sont amené·e·s à lire dans les manuels scolaires de français L1, en termes d’époque, d’origine de leur auteur, etc. ?
-
les savoirs littéraires analytiques : quels sont les savoirs analytiques que les manuels proposent aux élèves de s’approprier, avec quelles démarches et dans quels buts ?
-
les activités de réception de poèmes : lorsque les élèves reçoivent (lisent et/ou écoutent) un poème, quelles sont les activités proposées pour exploiter cette réception ?
-
les activités de production à partir de poèmes : quelles sont les activités de production proposées comme tâches finales dans les manuels (tâche d’UAA 5 et/ou d’UAA 6) ?
En choisissant de fonder l’analyse sur des manuels scolaires, nous faisons écho à des propos de Dufays (1999, p. 6) qui écrit que « l’étude des manuels est une activité clé […] pour la recherche didactique » et selon qui, « [d]u point de vue de la recherche, le manuel apparait comme un support privilégié pour l’étude des discours et des choix didactiques de l’école ».
Afin d’éclairer le propos sur les manuels scolaires, nous ferons ponctuellement référence au prescrit légal en vigueur en FWB lorsque ces manuels ont été conçus et dont les auteur·rice·s ont par conséquent dû tenir compte. Il s’agit du référentiel Compétences terminales et savoirs requis en français (2018 — que nous appellerons désormais Référentiel), commun à l’ensemble des réseaux d’enseignement, et de sa traduction en programmes par les deux principaux réseaux de la FWB : le réseau officiel WBE (Service général de l’Enseignement et Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné, 2018) et le réseau libre FESeC (Enseignement catholique secondaire, 2018a, 2018b), catholique.
1.2. Résultats
1.2.1. Corpus littéraires
Les corpus observés concernent essentiellement la littérature patrimoniale de différentes époques (du xve au xxe siècle : Villon, Ronsard, Malherbe, Vigny, Hugo, Baudelaire, Verlaine, Éluard, Valéry, Prévert, Michaux, etc.) et n’envisagent que la littérature française (avec toutefois un passage par la littérature francophone de Belgique dans le Connexion Français 3, Documents et fiches outils, p. 112-113). À l’exception de Marceline Desbordes-Valmore, tous les auteurs sont des hommes. Les structures classiques (poèmes en vers réguliers, rimés, structurés en strophes, etc.) sont plus représentées que les structures modernes (poèmes en prose, vers libres, etc.). Ceci rejoint le propos de Siméon, qui met en évidence la « forte prédominance du corpus classique dans les classes » (1996, p. 133) et qui évoque en outre l’existence d’un « corpus de textes restreint et encore trop conservateur » (2012, p. 17).
La poésie contemporaine est absente des corpus, qui ne contiennent aucun·e auteur·rice vivant·e. En outre, la poésie majoritairement étudiée est celle du xixe siècle (Baudelaire, Hugo, Lamartine, Musset, etc.). Pour les manuels de quatrième (Parcours & moi Sup’ 4, p. 42-44 et p. 50-54 ; Point-virgule 4, Référentiel, p. 89-91 et p. 102-107 ; Connexion Français 4, Documents et fiches outils, p. 149-153), ce choix répond aux exigences du prescrit légal : le Référentiel impose l’étude du romantisme en quatrième (p. 63). Ce constat d’une présence massive du xixe siècle se retrouve chez Brunel (2016, p. 78) — « Du côté des siècles privilégiés, […] la grande majorité des textes étudiés appartiennent au xixe siècle, qui fait office de siècle ressource » —, même si son corpus est constitué de manuels pour le collège, et chez Canvat et Legros (1997, p. 6) qui émettent une hypothèse explicative :
nous pouvons avancer que la restriction du corpus poétique scolaire aux grands « mages » du Romantisme et à leurs successeurs immédiats s’explique par la glosabilité des textes retenus, c’est-à-dire par la lisibilité, l’accessibilité de leur teneur psychologique et morale. (Canvat et Legros, 1997, p. 22)
Le surréalisme, abordé dans Parcours & moi Sup’ 3e degré, est lui aussi imposé par le prescrit, au troisième degré du secondaire. Les autres courants traités dans les séquences font dans tous les cas partie du « Cadre des connaissances littéraires et artistiques » du Référentiel (p. 60-62), dont la visée est de suggérer une série d’objets d’étude plutôt que de les prescrire. Si la section contemporaine de ce cadre (« Après 1968 ») n’est pas un imposé du prescrit, le réseau WBE (p. 62-64) demande d’aborder des « aspects de la culture contemporaine » (un en quatrième, deux en cinquième, deux en sixième), à savoir une tendance, un·e artiste, un genre, etc. ; la poésie contemporaine n’y est pas citée explicitement, mais l’utilisateur·rice est néanmoins libre d’estimer qu’elle peut être envisagée comme un de ces « aspects ».
En écho à Brillant Rannou et Boutevin (2018, p. 13), nous observons que, dans les manuels, les séquences visant la lecture d’une œuvre intégrale ne portent jamais sur un recueil de poèmes. Cette pratique ne rencontre pas la préconisation de Siméon (1996, p. 135) : « [les anthologies] ont […] le grave inconvénient d’interdire […] un accès […] à la poétique propre d’un auteur : ce n’est que dans […] un recueil qu’on peut appréhender la “silhouette” […] d’un poète ». La lecture intégrale d’un recueil de poèmes est pourtant suggérée dans le réseau WBE (p. 66), mais cette option ne semble pas avoir été retenue dans les manuels.
1.2.2. Savoirs littéraires analytiques
Dans notre corpus, il semble y avoir deux approches en tension. La première concerne trois des six séquences, où les apprentissages relatifs aux savoirs analytiques abordés lors de l’étude de textes poétiques se limitent surtout à l’analyse de figures de style. Celles-ci sont parfois étudiées dans le cadre de la lecture d’un texte poétique (Parcours & moi Sup’ 4, p. 20, p. 22 et p. 24), parfois indépendamment de toute lecture de poèmes (Point-virgule 4, Cahier d’activités, p. 153-155). L’essentiel de l’apprentissage se concentre sur l’identification (repérer et nommer les figures) (Parcours & moi Sup’ 4, p. 26 ; Parcours & moi Sup’ 3e degré, p. 15), rarement sur la recherche du ou des sens produit(s) ou sur le questionnement quant à l’utilisation de ces procédés d’écriture. La seconde approche concerne une collection de manuels : dans les séquences des Connexion Français, les figures de style sont abordées avec parcimonie et, souvent, associées à un questionnement relatif à leurs effets sur le lecteur (Connexion Français 4, Cahier d’activités, p. 208 ; Connexion Français 5, p. 209 et p. 220). Notons également que, dans certaines séquences, à un apprentissage visant l’identification des figures de style vient s’ajouter un apprentissage relatif à d’autres aspects formels des textes poétiques : la versification (dénomination des strophes selon le nombre de vers, types de rimes, etc.) dans Parcours & moi Sup’ 4 (p. 57) ou bien la prosodie, la versification et les formes poétiques fixes dans le Point-virgule 4, Cahier d’activités (p. 138-152 et p. 160).
Siméon (1996, p. 133) constatait une « focalisation du métadiscours des maitres sur les caractéristiques formelles » des textes poétiques abordés en classe, ce que Brunel (2016, p. 80) nous dit également — « apparaissent presque systématiquement des mentions sur la versification, l’analyse de figures de style ou de champs lexicaux » —, de même qu’Émery-Bruneau (2020, p. 2) — « les pratiques visent plutôt à étudier des notions littéraires dans le but de les repérer dans les poèmes » —, ainsi que Brillant Rannou et Boutevin (2018, p. 14), qui évoquent une « obsession formelle de la versification » au lycée. Émery-Bruneau (2020, p. 13) pointe aussi « quatre savoirs fondamentaux qui reviennent dans la majorité des cas et qui renvoient tous à des critères internes aux textes littéraires : figures de style, formes et structure des textes, règles de versification, champs lexicaux et thèmes » : on retrouve bel et bien ces savoirs dans les séquences étudiées au sein des manuels scolaires de notre corpus.
À côté des savoirs, les séquences analysées ne mettent pas en place une méthode de lecture propre au texte poétique et à l’expérience de lecture et/ou d’écoute que peuvent en faire les lecteur·rice·s. De même, la poésie est le plus souvent étudiée en tant que production à l’intérieur d’un mouvement littéraire, non comme genre à part entière (à l’exception du Connexion Français 3, Cahier d’activités, p. 146). Cet angle d’étude du texte poétique est cependant cohérent par rapport au référentiel : l’entrée en littérature par les genres est prescrite en troisième année (Référentiel, p. 63) et seul le programme du réseau WBE envisage d’étudier la poésie en tant que genre (« on identifiera les critères qui font d’un texte un poème (disposition, versification, liberté par rapport au langage normé) », p. 62).
1.2.3. Activités au sein des séquences
Deux tendances nettes sont observables dans les séquences étudiées. Soit le texte poétique est lié à un apprentissage de savoirs liés au patrimoine littéraire (romantisme, surréalisme, figure du « poète maudit », etc.), soit il est utilisé pour interroger la poésie en tant que genre.
La première tendance aborde les poèmes de manière systématique et répétitive par le biais de questionnaires. L’objectif semble être de permettre à l’élève de mieux saisir le sens du texte, d’en affiner la compréhension et de le relier à un courant particulier, avec deux visées :
-
soit une visée technique : il s’agit d’identifier des figures de style, une tonalité, un champ lexical, l’expression d’un sentiment, etc. (Parcours & moi Sup’ 4, p. 20-21 ; Parcours & moi Sup’ 3e degré, p. 13 et p. 48-49 ; Point-virgule 4, Cahier d’activités, p. 172 et p. 174 ; Connexion Français 4, Cahier d’activités, p. 203-204) ;
-
soit une visée centrée sur l’appréciation de l’élève ou sa rencontre avec l’œuvre littéraire, par exemple : « Individuellement, expliquez oralement ce que vous pensez du message véhiculé par ce poème. Est-il toujours d’actualité ? », « Ce poème vous a-t-il plu ? Vous a-t-il touché(e) ? Individuellement, développez oralement votre réponse et illustrez-la par des références précises au poème » (Parcours & moi Sup’ 4, p. 25) et « Quel poème préfères-tu ? Justifie ta réponse à l’aide d’éléments issus du texte choisi et en faisant part de ton ressenti » (Parcours & moi Sup’ 3e degré, p. 41).
Le constat que nous posons ici rejoint ceux (relatifs à d’autres corpus, cependant) de Brillant Rannou et Boutevin (2020, p. 182) — « l’interprétation de la poésie est souvent réduite à l’observation de sa rhétorique » — et d’Émery-Bruneau (2018, p. 7) : « Les manuels visent surtout à former des lecteurs inscrits dans une posture […] analytique, la présence du sujet lecteur apparaissant faiblement sinon dans les quelques questions d’appréciation ».
La deuxième tendance, présente essentiellement dans les manuels scolaires de la collection Connexion Français (Van In), prend davantage en compte le sujet lecteur ; l’expression des réactions de ce dernier semble être l’objectif premier des activités menées : « Quel est le poème que tu préfères ? Pourquoi ? » (Connexion Français 3, Cahier d’activités, p. 147), « Apprécies-tu ce texte ? », « Correspond-il à tes attentes ? », « Les activités auxquelles il a donné lieu t’ont-elles permis de mieux l’apprécier ? » (Connexion Français 4, Cahier d’activités, p. 205), « Y a-t-il dans ces poèmes des vers ou fragments qui te paraissent particulièrement forts, particulièrement réussis ? » (Connexion Français 5, p. 209), etc.
On pourrait néanmoins s’interroger plus globalement sur les deux tendances que nous venons d’évoquer : les différentes activités proposées dans les séquences analysées, puisqu’elles n’amènent pas l’élève à se positionner sur le genre même du texte, ne semblent pas tenir compte des spécificités du genre poétique, dans la mesure où elles pourraient facilement s’appliquer à d’autres textes littéraires ou à des œuvres picturales, par exemple.
1.2.4. Tâches finales des séquences
En préambule, notons que l’enseignement-apprentissage (toutes disciplines confondues) en FWB s’inscrit dans la pédagogie par compétences et le prescrit légal — y compris celui pour le cours de français L1 — insiste sur le lien à opérer entre savoirs, savoir-faire et savoir-être. Autrement dit, l’étude d’un genre littéraire, d’un courant artistique, etc. ne doit jamais être envisagée comme une fin en soi, mais doit être réinvestie dans une production (une tâche finale), écrite ou orale, elle-même étant à envisager comme un acte de communication.
Dans les six séquences analysées, les productions proposées au terme des apprentissages visent essentiellement une UAA du prescrit : l’UAA 5, « S’inscrire dans une œuvre culturelle ». Au sein de cette UAA 5, trois « procédés créatifs » peuvent être mis œuvre (Référentiel, p. 35) :
-
l’amplification : « combler une ellipse, développer un élément simplement évoqué, poursuivre une œuvre narrative ou poétique, élargir le champ d’une image » ;
-
la recomposition : « créer une nouvelle œuvre par déplacement ou suppression d’éléments d’une ou plusieurs œuvres sources » ;
-
la transposition : « transposer (de façon sérieuse, ludique, parodique…) une œuvre […] en conservant le même langage (écrit, sonore, iconique […]) ou en en changeant ».
Nous reprenons ici quelques exemples de tâches finales relevant des procédés de l’UAA 5 :
-
l’amplification : « Choisis un des poèmes proposés […]. Écris huit à dix vers respectant le(s) thème(s) repéré(s) ainsi que la structure d’origine. Veille à jouer avec les sonorités et les images et insère dans ta création deux figures de style différentes que tu souligneras et nommeras dans une note de bas de page » (Point-virgule 4, Cahier d’activités, p. 178) ;
-
la recomposition : « Choisis des vers dans deux ou trois poèmes différents et recompose un poème romantique. […] ton poème devra comporter trois figures de style différentes que tu souligneras et identifieras dans la marge. […] Tu mettras également en évidence cinq éléments de versification différents […] que tu légenderas » (Parcours & moi Sup’ 4, p. 62) et « À partir des poèmes du portfolio, créez un poème inédit en utilisant le procédé de la recomposition et en suivant les règles » (Parcours & moi Sup’ 3e degré, p. 62) ;
-
la transposition : « Prends connaissance du poème […] et transpose-le en respectant les consignes » (Connexion Français 3, Cahier d’activités, p. 156) et « Production attendue : Diapoème : texte du poème original, images, musique, sous la forme d’un diaporama » (Connexion Français 4, Cahier d’activités, p. 201).
Ces tâches respectent le prescrit légal. Il appartient néanmoins à l’enseignant·e d’éviter des pratiques avec lesquelles la recherche prend ses distances. Canvat et Legros (1997, p. 22) évoquent à ce propos « certains “jeux poétiques” […] qui, pour beaucoup d’élèves, jouent le rôle d’écran, voire de répulsif, l’entreprise poétique leur apparaissant comme un amusement vain ». Émery-Bruneau (2018, p. 7) rappelle, quant à elle, que l’imitation peut conduire à des pratiques d’enseignement-apprentissage dont le sujet scripteur est absent.
Les tâches finales faisant une place à la réception de poèmes par l’élève sont rares. Ainsi, dans le Parcours & moi Sup’ 4 (p. 62), l’élève reçoit la consigne « Réalise le récit d’expérience d’une rencontre avec cette œuvre culturelle ». S’il y a dans le Parcours & moi Sup’ 3e degré (p. 62) une tâche où l’élève rédige un compte rendu de sa rencontre avec un poème, il s’agit en fait d’un texte produit par ses pairs (une recomposition à partir de poèmes fournis par l’enseignant·e), ce qui pourrait manquer d’authenticité au regard des pratiques de référence.
1.3. Synthèse et discussion des résultats
On observe globalement, à l’échelle du corpus, une manière similaire d’aborder la poésie : c’est avant tout un objet patrimonial dont les caractéristiques formelles sont étudiées de manière dispersée avec une importance particulière et réductrice accordée aux figures de style, présentées comme étant la spécificité du langage poétique ; les pratiques d’écriture contemporaines, plus libres et parfois plus résistantes, n’apparaissent pas au sein du corpus. De plus, la littérature poétique francophone hors de France y est pratiquement absente et le corpus est presque exclusivement masculin. Si le texte poétique peut donner lieu à des activités qui permettent à l’élève d’exprimer son ressenti face au texte (mais cela ne survient que de manière très ponctuelle) ou de « jouer » avec le matériau poétique, ces activités n’offrent pas à l’élève la possibilité de s’exprimer hors du cadre de l’objet étudié ou de s’interroger sur les particularités du langage poétique face à d’autres moyens d’expression. La poésie est abordée comme un objet d’étude, jamais comme un moyen d’expression pour les élèves (et, quand c’est le cas, c’est dans des pratiques du type « à la manière de » ou fondées sur le principe de la recomposition). On déplorera aussi l’omniprésence des savoirs analytiques dont l’articulation avec le sujet lecteur s’avère rare alors même que le référentiel (p. 45) évoque le modèle de la lecture littéraire de Dufays et al. (2015, p. 95-96). Ce constat fait écho à un propos déjà ancien de Canvat (2003, p. 12) : « la poésie reste, dans l’enseignement en Belgique francophone, davantage lue qu’écrite ou dite, et […] les lectures “analytiques” — qui privilégient la distanciation — continuent de l’emporter sur les lectures “cursives” — qui privilégient la participation/adhésion ». En écho à l’approche de la poésie proposée par Dufays (2004) et qui met en œuvre le « va-et-vient dialectique » caractéristique de la lecture littéraire (Dufays et al., 2015, p. 95-96), il nous parait important d’amener les élèves du secondaire à appréhender les textes littéraires poétiques avec une posture critique (la distanciation) et une posture fondée sur l’investissement psychoaffectif (la participation).
Face à ces différents constats, si certaines approches présentes dans les manuels scolaires sont malgré tout appréciables, ceux-ci nous semblent participer, dans l’ensemble, d’une vision réductrice de la poésie (que cela soit en termes de formes ou de thèmes). Le dispositif que nous allons présenter en deuxième partie de cette contribution fournit un contrepoint aux pratiques observées dans les séquences de manuels scolaires dans la mesure où il permet d’éviter un certain nombre d’écueils parmi ceux que nous avons soulignés ci-dessus.
2. Pistes pour une didactique professionnelle : le « Poetic Lab »
Comme le souligne Dufays (2004, p. 20), « le travail sur la poésie ne peut vraiment prendre sens aujourd’hui que s’il est vécu dans le cadre d’un projet négocié entre l’enseignant et sa classe, c’est-à-dire dans la perspective d’une production finale de quelque envergure qui mobilise un ensemble d’apprentissages et parait motivante aux yeux des élèves ». C’est dans cet esprit que, depuis 2019, dans le cadre d’une recherche-création subsidiée par la FWB et soutenue dans la durée par un projet intitulé « La Plume au bout de la langue3 », Charlyne Audin, didacticienne du français L1 à la Haute École Charlemagne (Liège) développe avec ses étudiant·e·s futur·e·s enseignant·e·s un laboratoire poétique. Ce projet, qui prend ancrage dans le cadre des deuxième et troisième années de formation initiale, s’intitule « Poetic Lab4 » et a commencé à essaimer dans les établissements d’enseignement secondaire de Liège. Ce laboratoire de lecture-écriture poétique est coanimé par des poètes et poétesses et des didacticien·ne·s du français L1. Il vise non seulement la découverte d’une offre culturelle contemporaine locale répondant aux exigences du « Parcours d’éducation culturelle et artistique » (le PECA) en vigueur aujourd’hui en FWB, mais il place aussi la langue poétique au centre des préoccupations linguistiques des futur·e·s enseignant·e·s de français L1.
Le « Poetic Lab » se déroule sur deux années académiques où, durant une trentaine d’heures, les étudiant·e·s participent à des ateliers animés par au moins trois poètes et poétesses belges contemporain·e·s5, sélectionné·e·s par leur enseignante, Charlyne Audin, pour leurs approches différentes de la poésie : typographes, anthologistes, parolier, danseuse, performeuses, slameuses, militantes, polyglottes, traductrice, illustratrice, etc. La majorité des invitations est lancée auprès de femmes et tous·tes les artistes sont belges, à deux exceptions près. Chaque artiste passe au moins six heures avec un groupe d’une quinzaine d’étudiant·e·s. Par la pluralité de ses intervenant·e·s, le projet rejoint les visées suivantes :
dans une perspective essentiellement didactique, la poésie en tant qu’objet d’enseignement inclut à la fois un langage (écrit-oral), des performances vocales et corporelles (entendues/visionnées, produites), des savoirs (sociaux, langagiers, historiques) et des genres poétiques variés (poème lyrique ou engagé, chanson, slam, etc.) déterminés par le champ de production (maisons d’édition de poésie, manifestations poétiques, rôle social, politique ou linguistique du poète, etc.) et de réception (expériences poétiques singulières de sujets lecteurs, scripteurs, auditeurs, spectateurs et/ou performeurs). (Émery-Bruneau, 2018, p. 3)
Chaque atelier est unique, mais chaque invité·e est amené·e dans un premier temps à disposer des textes sur des tables, et tout·e étudiant·e finit par s’intéresser à un poème6. La première étape consiste donc à lire ou à écouter des textes poétiques, à rencontrer aléatoirement la langue ou non et à se laisser happer, le cas échéant, par leurs productions. La démarche rejoint les principes exposés par Martin :
pas de poèmes courts sans poèmes longs […] ; […] pas de poèmes en langue française sans poèmes en langue étrangère, éventuellement, voire le plus souvent traduits […] ; pas de poèmes classiques sans poèmes contemporains, pas de modernes sans anciens ; pas de poèmes réputés savants sans poèmes classés populaires et l’inverse ; pas de poèmes en vers sans poèmes en prose […] ; pas de narrations poétiques sans descriptions poétiques et l’inverse ; pas d’approche sonore sans approche visuelle et pas d’attention visuelle sans écoute des poèmes ; enfin pas de poèmes à savourer sans aussi les réfléchir et pas de poèmes à analyser sans y prendre gout, y prendre corps… (Martin, 2010, p. 9)
Par la suite, au détour de consignes négociables, héritées de formes observées chez des auteur·rice·s ancien·ne·s ou contemporain·e·s, lu·e·s et épinglé·e·s pour telle tournure, telle assonance, tel usage de la métaphore, de la page blanche ou du retour à la ligne, etc., les intervenant·e·s lancent un geste de libération de l’écriture ; puisque chacune de ces consignes d’écriture se fonde à priori, par induction, sur les caractéristiques formelles d’un poème observé, chaque piste d’écriture est adaptée aux aptitudes et faiblesses des étudiant·e·s. Durant cette deuxième phase au temps lent (en moyenne deux heures de production accompagnée, entravée de contraintes progressives, de biffures, de bifurcations, de caviardage, etc. propres à chaque invité·e), les étudiant·e·s écrivent à leur rythme, pouvant piocher des mots, des sons, des images dans les textes préalablement lus ou formulés au départ de supports picturaux, sonores, voire bruitistes. Chaque texte produit prend donc une forme différente, mais tous ont une visée de communication authentique, qu’elle soit orale, par la prise de parole publique, ou écrite, par la diffusion de recueils ou de fanzines, par le réseau des bibliothèques publiques ou par des expositions typographiques dans des galeries locales. Les attentes communicationnelles finales sont toujours rappelées, mais la liberté est laissée à chacun·e de « passer son tour » lorsqu’il ou elle ne désire pas partager son texte poétique à un moment donné du processus.
La posture d’édition que demande cette dernière phase permet de renforcer, par une pratique concrète et réflexive sur la langue poétique, des pistes soulevées dans le cadre du cours relatif aux outils de la langue : « Par quels moyens linguistiques puis-je renforcer l’expression de telle émotion ? », « Si j’ôte ce mot, ce groupe de mots ou cette proposition, ma phrase est-elle toujours syntaxiquement correcte ? », « Qu’est-ce que cela change pour celui ou celle qui la reçoit ? », « Puis-je apporter un complément à ce verbe intransitif ? », « Est-il possible de transformer un nom en verbe d’action ? », « Pourquoi, en poésie, ne le pourrait-on pas, en fait ? », etc. Autant de moments collectifs de réflexion active sur la langue et sur ses débordements et ses licences quand il s’agit de style, à fortiori en poésie. Par ailleurs, si l’atelier le permet sur le plan matériel (et si l’accompagnement professionnel est présent), un travail d’illustration des objets-livres créés est également envisagé afin de vérifier la bonne compréhension des figures de style, qui sont alors transférées sur le plan iconique.
En guise de complément, les étudiant·e·s de troisième année, qui ont bénéficié l’année précédente de l’expérience du laboratoire poétique, animent à leur tour des ateliers auprès d’élèves de troisième année du niveau secondaire. Pour préparer ces ateliers, une médiatrice experte en animation d’ateliers d’écriture intervient en classe. Il s’agit là d’une occasion pour les étudiant·e·s futur·e·s enseignant·e·s de distinguer la posture d’animateur·rice d’atelier et celle d’enseignant·e, qu’ils et elles réinvestiront lors d’un retour en classe où seront identifiés les différents savoirs et savoir-faire langagiers exploités pendant ces ateliers.
Par sa méthodologie, axée sur le présent poétique (en réception et en production), le « Poetic Lab » tend, au cœur de la formation initiale des enseignant·e·s, à articuler la vivacité de la poésie contemporaine et une démarche réflexive en langue7, ce qui nous amène à rappeler avec Martin (2010, p. 12-13) que « les poèmes obligent à penser la langue par la voix et donc à inventer la grammaire chaque fois qu’on lit un poème c’est-à-dire à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur la langue […] dès que nous sommes avec des poèmes ». Ce laboratoire ne vise pas seulement à travailler auprès des étudiant·e·s futur·e·s enseignant·e·s une vision de la poésie contemporaine, avec une attention toute particulière à la langue, il entend également les sensibiliser à la place vive qu’elle occupe aujourd’hui dans la société.
Par isomorphisme, on peut espérer rendre pérennes des pratiques authentiques liées à la langue et à la poésie dans les futures classes du secondaire des étudiant·e·s. Il semblerait que ce soit le cas : si des actions isolées avaient déjà vu le jour dans des séquences observées lors de stages pédagogiques, 2023-2024 a constitué la première année où un étudiant a mené de A à Z son propre laboratoire en stage, invitant une poétesse rencontrée un an avant dans le « Poetic Lab », dans une classe de troisième année. Au détour de l’arpentage8 d’un recueil de l’autrice, l’étudiant a proposé une séquence s’inscrivant dans un devoir de mémoire, sur les femmes effacées de l’Histoire, pour les faire réapparaitre, à la manière du livre étudié9, sous la forme de biographies fragmentaires dans des fanzines diffusés par le réseau des bibliothèques publiques et dont les éditeurs responsables étaient les élèves. Par cette démarche, l’étudiant a pu faire ressentir à ses élèves qu’il était tout à fait possible de participer au monde (son histoire et ses luttes, entre autres) par le biais de la poésie, faisant de ce fait écho aux propos de Viart10 qui caractérise la littérature contemporaine comme suit : « littérature […] qui fait retour aux questions du sujet, de l’Histoire, du réel, ou plutôt qui s’intéresse au sujet, au réel, à l’histoire, au monde social comme questions » et « [elle] porte un regard critique […] sur le monde dont elle parle, et plus généralement sur ses objets ».
Conclusion
Face aux constats que nous avons posés après l’analyse de séquences de manuels scolaires (corpus limités au champ littéraire français et peu ouverts à la production contemporaine, activités didactiques accordant une grande importance aux savoirs littéraires au détriment du sujet lecteur, etc.), le projet mené en formation initiale d’enseignant·e·s à la Haute École Charlemagne (Liège) offre un exemple parmi d’autres d’un enseignement-apprentissage de la poésie à travers un dispositif qui évite les écueils observés dans les manuels scolaires de notre corpus. Le « Poetic Lab » montre en effet qu’il est possible d’investir la littérature poétique contemporaine, d’en rencontrer les acteur·rice·s, de féminiser les corpus, de rendre davantage les élèves sensibles à la langue poétique, d’inscrire la poésie dans des projets de communication authentique, et ce dès le début de la formation, de façon à ouvrir les futur·e·s enseignant·e·s à une manière d’être en poésie pour l’enseigner. Ce dispositif permet de sensibiliser les étudiant·e·s à certaines pratiques et, nous l’espérons, de diffuser celles-ci sur le terrain. Ainsi, le moment est peut-être venu de dégager du temps pour « penser à un enseignement de la poésie qui s’inscrirait en équilibre entre ces savoirs scolaires transmis par les enseignants, les expériences poétiques vécues par les sujets et le recours à ces savoirs pour analyser et expliquer leurs expériences » (Émery-Bruneau, 2020, p. 4).
La Réforme de la formation initiale des enseignants (RFIE) en FWB, qui a débuté en septembre 2023 et qui vise notamment à allonger la formation et à faire collaborer hautes écoles et universités, constitue un moment important pour les formateur·rice·s d’enseignant·e·s : il leur revient de sensibiliser les étudiant·e·s futur·e·s enseignant·e·s à l’importance de proposer une approche de la poésie mettant en œuvre la lecture littéraire (cf. propositions de Dufays, 2004) : une approche vive, en réception comme en production, mais aussi en équilibre avec les démarches qui visent des apprentissages d’ordre formel.