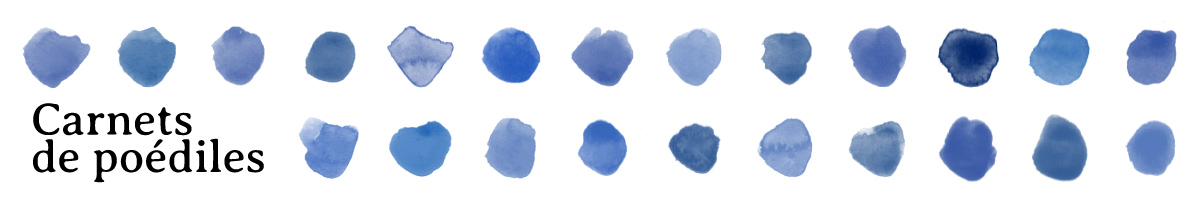Peu de recherches ont été consacrées à l’enseignement de la poésie au collégial1 au Québec. Quelques travaux, cependant, font état de la difficulté à faire lire de la poésie dans les cours de littérature, notamment parce qu’une vaste majorité d’élèves entretiendrait un rapport « souvent conflictuel » (Duval et Turcotte, 2007, p. 62) avec les textes poétiques. Duval (2002) considère, d’ailleurs, que la poésie est un genre littéraire « rebutant à aborder, tant pour les élèves du collégial que pour les enseignants » (p. 54). Faut-il y voir la cause de la raréfaction des textes poétiques dans les corpus scolaires au collégial, comme le déplorent Faivre-Duboz et Parenteau (2020) ? De l’avis même de certains poètes, cette situation semble tenir, au moins en partie, à la nature intrinsèque de la poésie, qui constitue « un objet d’étude difficile à cerner [...]. De sorte que parler de la poésie conduit la plupart du temps à tenir un discours mal approprié : trop technique ou trop subjectif. » (Maulpoix, 2005, p. 30). De fait, comme le révèlent les travaux de Goulet (2000) et plus récemment de Babin (2016), la lecture des œuvres littéraires dans les cours de littérature au cégep repose, la plupart du temps, sur une approche formaliste et techniciste des textes, ainsi que sur la connaissance de l’histoire littéraire (Marcotte, 1994 ; Roy, 2000), afin de répondre aux exigences de l’épreuve uniforme de français.
Dans son essai La vie habitable, la dramaturge et comédienne Véronique Côté plaide néanmoins en faveur d’une valorisation des dimensions affective et expérientielle de notre rapport à la poésie, afin d’inscrire cette dernière au cœur de notre existence et de contribuer à rendre notre « vie habitable ». Cette préoccupation trouve un écho dans des travaux consacrés à l’enseignement de la poésie (Duval et Turcotte, 2007 ; St-Onge, 2018) qui invitent justement à rompre avec des « pratiques d’enseignement de la poésie [...] figées » (Florey et Émery-Bruneau, 2023, n. p.) afin de favoriser une réception plus sensible des textes.
Le projet Marcher avec elle, conçu et scénarisé par Mariève Desjardins2, enseignante au département de français du Cégep de St-Jérôme (Québec), et produit par l’organisme Portrait sonore, s’inscrit dans cette perspective. Il propose de (re)découvrir l’œuvre de la poétesse québécoise Marie Uguay grâce à une déambulation sur les pas de cette dernière dans Ville-Émard, un quartier de Montréal où elle a vécu. Les élèves sont ainsi conviés à parcourir un itinéraire balisé, comprenant huit pauses à des endroits spécifiques, en écoutant (grâce à une application à télécharger) des extraits de poèmes et du journal de Marie Uguay, des fragments narrés présentant des éléments biographiques, historiques et urbanistiques, par le biais de capsules sonores et musicales faisant écho à la vie du quartier ou inspirées des lieux.
L’originalité de cette démarche et la volonté de sa conceptrice de viser, en particulier, les élèves du collégial, nous conduisent à nous interroger sur les modalités et les effets de l’expérience que Marcher avec elle est susceptible de faire vivre aux élèves. Dans quelle mesure, plus précisément, cette expérience peut-elle favoriser l’engagement dans la lecture de textes poétiques d’un public généralement considéré comme rétif à ce genre littéraire ?
Notre recherche exploratoire3 s’appuie sur le postulat qu’une expérience poétique fructueuse fait naitre ce que le sociologue Hartmut Rosa (2018) nomme la « résonance », à savoir un « rapport cognitif, affectif et corporel au monde dans lequel le sujet, d’une part, est touché par un fragment du monde, et où, d’autre part, il “répond” au monde en agissant concrètement sur lui, éprouvant ainsi son efficacité » (Rosa, 2018, p. 187). Elle se donne deux objectifs principaux : déterminer, à partir d’une étude de cas, dans quelle mesure les différentes composantes du parcours (les textes lus, les lieux empruntés, etc.) suscitent effectivement une expérience de résonance, et examiner en quoi cette résonance, lorsqu’elle a lieu, permet aux deux élèves interrogés de nouer un rapport moins « conflictuel » au genre poétique et, plus spécifiquement, de mieux comprendre et interpréter l’univers poétique de Marie Uguay.
1. Faire résonner l’expérience poétique
Bien qu’elles s’inscrivent dans des perspectives très différentes, la réflexion sur la poésie que présente la dramaturge Véronique Côté dans son essai La vie habitable et celle sur la « résonance », que le sociologue Hartmut Rosa propose dans Résonance : une sociologie de la relation au monde, entretiennent de nombreux points communs.
1.1. L’expérience poétique selon Véronique Côté
Dans La vie habitable, Véronique Côté tente de préciser les caractéristiques de sa conception de la poésie, qu’elle lie étroitement à l’idée de mouvement. Selon ses propres termes, il s’agit d’une « poésie en marche », d’une « poésie mouvante, émouvante, bougeant en nous en nous invitant de ce fait à nous mettre en mouvement » (p. 12). La métaphore de la marche lui sert, en particulier, à interroger notre besoin de poésie dans un monde qu’elle juge formaté par les impératifs économiques. Puisque, selon elle, notre conception même de la beauté n’échappe pas à la « logique marchande » (p. 20), Véronique Côté cherche à opérer un reconditionnement à partir duquel nous (ré)apprendrons à regarder la beauté gratuite, sauvage, inutile, dans ce qui nous entoure. On ne sera peut-être pas surpris de constater que les propos d’une dramaturge fassent écho à ceux de plusieurs poètes contemporains, pour qui « l’expérience poétique excède toujours amplement le poème : elle le précède et parfois, par bonheur, lui survit » (Brillant-Rannou, 2004, p. 100). Il peut sembler plus inattendu, en revanche, que la conception de l’expérience poétique de Véronique Côté présente plusieurs affinités avec celle de la « résonance », considérée par le sociologue Hartmut Rosa comme le fondement d’une relation harmonieuse avec le monde.
1.2. La résonance
Les premiers mots de Résonance. Sociologie de la relation, publié par Hartmut Rosa en 2018, annoncent clairement que cet ouvrage se situe dans le prolongement d’un autre essai, Accélération : une critique sociale du temps, paru quelques années plus tôt : « Si le problème est l’accélération, alors la résonance est peut-être la solution. » (Rosa, 2018, p. 7). S’interrogeant sur ce qui distingue les « relations au monde réussies et ratées » (ibid., p. 48), Hartmut Rosa fait de la résonance l’élément déterminant de cette réussite ou de cet échec. En effet, pour lui, la résonance procède, fondamentalement, de la capacité de l’être humain à être touché par son environnement matériel ou naturel et à y répondre à son tour. À l’instar de Véronique Côté, qui considère que le poème n’est pas le seul lieu où vivre une expérience poétique, Hartmut Rosa insiste sur le fait que la résonance peut survenir en diverses circonstances, que ce soit, par exemple, la contemplation d’une œuvre d’art, des relations humaines riches et harmonieuses ou un contact particulier avec les choses matérielles4. De plus, ce « lien vibrant au monde » n’opère pas en disposant des choses, mais plutôt en entrant en résonance avec elles, dans la mesure où « [l]a faculté de résonance se fonde sur l’expérience préalable d’un élément étranger qui nous déconcerte, que l’on ne s’est pas approprié et qui surtout reste indisponible, se dérobe à toute prise et se soustrait à toute attente. » (ibid., p. 212).
Faire résonner l’expérience poétique, telle que nous l’envisageons, n’exclut donc nullement de lire des poèmes. Au contraire, les propos de Véronique Côté et d’Hartmut Rosa nous amènent à penser qu’ils peuvent constituer un terreau fertile afin d’entrer en résonance. En effet, comme l’a bien montré Chklovski, alors que le langage quotidien instaure un rapport de reconnaissance avec le monde qui nous entoure en nous habituant à percevoir ce dernier de manière automatique, le langage poétique vise, au contraire, « la libération de l’objet de l’automatisme perceptif » (1965, p. 83). Comme nous l’avons rappelé plus haut, dans les classes de littérature, au collégial, la plupart des jeunes lecteurs sont, justement, intimidés par le genre poétique, parce qu’ils le connaissent généralement mal et qu’il leur fait éprouver une expérience, de prime abord, déroutante.
Cependant, la prise de conscience de multiples sources possibles de résonance ou de l’existence d’une poésie hors du poème peut aussi permettre à ces mêmes élèves de mieux saisir ce qui donne naissance à ce dernier. Dans la perspective de Véronique Côté, en effet, il n’y a pas de rupture entre l’expérience vécue par un individu et le poème mais, au contraire, une forme de continuité, une transposition, avec les outils du langage, de cette expérience dans une forme que l’on appelle justement : « poème ».
En somme, nous considérons, d’une part que l’immersion conjointe des élèves dans l’univers poétique de Marie Uguay et dans un quartier de la ville peut leur faire vivre « un rapport cognitif, affectif et corporel » (Rosa, 2018, p. 187) à la fois au poème et au monde, et, d’autre part, que cette forme particulière de relation à un texte littéraire et à l’espace recèle des vertus pédagogiques puisque « la connaissance n’advient et ne vaut que chevillée à l’expérience, et que le savoir se construit sur les bases d’un vécu effectif, personnel, voire sensoriel » (Brillant-Rannou, 2016, n. p.).
2. Suivre l’écho des pas de Marie Uguay : la promenade littéraire comme dispositif pour mettre la poésie en marche
La notion de « promenade littéraire » désigne une pluralité de pratiques qui se distinguent autant par leurs modalités que par leurs objectifs. Rachel Bouvet, chercheuse spécialiste en géopoétique, rappelle que la valorisation du patrimoine est loin d’en être le principal : « Très souvent s’ajoute en effet un objectif de découverte, à la fois des lieux et des œuvres » (2019, p. 113-114). À cet égard, comme Véronique Côté, Rachel Bouvet insiste particulièrement sur l’importance de la « lecture en mouvement » (ibid., p. 114), afin de favoriser la « mise en relation entre le texte et le lieu » (ibid., p. 134). Plus précisément, selon la chercheuse, « [l]a connaissance des lieux s’affine avec la lecture, et, inversement, la compréhension du texte s’enrichit grâce à l’expérience vécue in situ » (ibid., p. 114). Dans cette perspective, « la promenade littéraire […] [est] considérée comme une lecture augmentée d’un texte ou d’un lieu » (ibid., p. 110) en ce qu’elle constitue un acte de construction de sens et de significations qui implique, précisément, les sens (en particulier la vue, mais aussi l’ouïe et l’odorat, par exemple). À ce titre, il est important de noter que c’est bien le processus de lecture (tel qu’il est défini juste au-dessus) qui est augmenté, et non le lieu ou le texte (comme ils pourraient l’être avec des dispositifs de réalité augmentée ou virtuelle, tels que ceux proposés par certains musées5).
Les participants à la promenade littéraire Marcher avec elle sont, justement, amenés à (re)découvrir l’œuvre de Marie Uguay au gré d’un parcours sonore dans Ville-Émard. Cette promenade tend à offrir un accès particulier à l’œuvre de la poétesse québécoise, en ce qu’elle tente d’amener les participants à vivre une expérience singulière fondée sur la relation conjointe à l’univers poétique de Marie Uguay et au quartier traversé lors du parcours.
Le choix de l’œuvre de Marie Uguay tient, d’abord, aux caractéristiques du « genre de la poésie [qui] se prête naturellement bien à la balade littéraire en raison de son caractère bref » (ibid., p. 125), mais aussi à celles, plus spécifiquement, de l’univers poétique de Marie Uguay. En 1981, cette dernière succombe, à 26 ans, des suites d’un cancer des os, qui a causé l’amputation d’une de ses jambes deux ans plus tôt. Bien que sa brève existence ait été marquée par la maladie et la souffrance, son œuvre est porteuse d’une véritable pulsion de vie. Nous considérons, à cet égard, que plusieurs thèmes récurrents dans ses poèmes (en particulier l’amour, la souffrance, et l’intensité du moment présent) sont, à priori, susceptibles d’interpeller des élèves de 17-20 ans.
De plus, son œuvre poétique se prête très bien à un parcours dans la ville tant les paysages, notamment urbains, défilent abondamment dans ses vers. Marie Uguay y parle beaucoup de Montréal comme d’un endroit qui l’a inspirée, car la métropole québécoise recèle une infinité de sensations à explorer. Dans son journal, elle déclare notamment adorer se promener dans cette ville, s’y sentir dépaysée, explorer ses lignes de fractures ainsi que sa diversité. Pour elle, Montréal n’est pas une belle ville dans le sens habituellement donné au mot « beauté », et c’est ce qui pousse justement la poétesse à nous inviter à la trouver belle à sa façon, malgré son apparente banalité, et à y déceler des splendeurs insoupçonnées. Cette apparente banalité, que l’on peut observer en marchant entre les arrêts du parcours, permet, d’ailleurs, peut-être plus aisément d’entrer dans un mode contemplatif ou de trouver des sources inédites d’intérêt dans le paysage urbain puisque « même les fragments de monde tendanciellement inhospitaliers et hostiles […] peuvent devenir, sous certaines conditions, de véritables oasis de résonances. » (Rosa, 2018, p. 35)
Enfin, dans son journal, Marie Uguay évoque à plusieurs reprises un singulier rapport au monde, qui nous apparait particulièrement résonant. C’est le cas, notamment, lorsqu’elle décrit sa conception de la poésie et sa venue à l’écriture, qui est pour elle une manière de saisir la beauté dans les lieux et les objets du quotidien, de retrouver une exaltation dans l’exploration des sensations. Les perspectives croisées qu’offre la lecture d’extraits du journal et de poèmes, dans les capsules sonores de la promenade littéraire Marcher avec elle, visent précisément à montrer que l’expérience poétique ne se réduit pas au poème et que ce dernier n’est, en quelque sorte, qu’une forme de concrétisation et qu’un moyen de partager cette expérience vécue intimement.
Pour toutes ces raisons, Marie Uguay semble constituer une guide privilégiée pour le marcheur.
3. Méthodologie de la recherche
3.1. Protocole expérimental
Deux élèves (Anis et Renaud6) de deux collèges différents participent à l’expérimentation durant laquelle ils prennent part, successivement, à un premier entretien, effectuent le parcours Marcher avec elle, puis passent une seconde entrevue7. Avant le parcours, ils ont été interrogés sur leurs perceptions de la poésie et sur leur appréciation d’un poème de Marie Uguay (qu’ils ont dû choisir parmi trois poèmes entendus dans les capsules sonores accompagnant le parcours). Puis, ils sont invités à prendre part à la promenade littéraire et à saisir une trace de ce qui, selon eux, représentent une forme d’entredeux, car il s’agit d’un motif récurrent de la poésie de Marie Uguay. Cette trace peut être une description verbale, une photographie ou une captation sonore, que les répondants doivent accompagner d’une brève explication éclairant les raisons de leur choix. Enfin, lors du second entretien, les participants sont interrogés sur leur appréciation du parcours sonore, ainsi que sur les effets qu’il a produits sur leur perception de la poésie et sur leur interprétation du poème choisi lors du premier entretien. Ils doivent également expliquer comment ils ont interprété et saisi une manifestation de l’entredeux lors de leur parcours. Les premiers entretiens sont semi-structurés, tandis que les seconds reposent sur une discussion libre (Boutin, 2018). Le choix de l’entretien semi-structuré nous semble adéquat, car il favorise des échanges entre la personne qui interroge et le répondant à partir de questions ouvertes préparées en amont. Ainsi, bien que cette méthode offre une certaine souplesse dans les échanges, ces derniers demeurent balisés par une trame, ou une série de questions, elles-mêmes guidées par les objectifs de la recherche. À contrario, l’entretien libre repose sur des échanges spontanés (sans que les questions soient rédigées au préalable). Nous choisissons d’y avoir recours lors de la seconde rencontre, car elle permet une approche plus large du sujet et offre au répondant l’occasion d’approfondir des aspects que l’équipe de recherche pourrait ne pas avoir envisagés.
3.2. Profil des répondants
Les participants ne connaissent pas Marie Uguay avant de prendre part à la recherche. Ils ne sont pas non plus inscrits dans un programme d’Arts et Lettres et n’ont jamais participé à une promenade littéraire avant l’expérimentation.
Anis, âgé de dix-huit ans, est inscrit dans un programme en gestion commerciale. Lors d’une session antérieure, il a suivi un cours de littérature, mais il ne fournit pas de précisions sur son contenu. Il déclare qu’il n’« aime pas vraiment la littérature » et explique éprouver des difficultés à comprendre les textes littéraires, en particulier ceux lus à l’école : « Dans les romans, j’ai de la difficulté à visualiser genre les événements qui se passent ». La lecture de poèmes suscite des difficultés du même ordre. Anis mentionne, à propos de la poésie, en avoir lu et écrit lorsqu’il était au primaire. Il précise que cela ne lui en a pas laissé un souvenir particulièrement plaisant. Aujourd’hui, il n’a pas de pratique d’écriture en dehors du cadre scolaire et ne manifeste pas un intérêt particulier pour des formes poétiques telles que le slam ou le rap. Cependant, le jeune homme s’investit dans diverses activités artistiques et créatives (notamment la réalisation de vidéos). Il mentionne, par ailleurs, aimer le cinéma parce que l’association des images animées et du son favorisent son immersion et sa compréhension de ce qui est représenté à l’écran.
D’une manière générale, Anis mentionne s’ennuyer en classe, en partie parce qu’il considère que les cours (notamment celui de français, qui fait partie de la formation obligatoire au collégial) ne lui permettent pas d’acquérir des compétences utiles en dehors de l’école. Il estime également qu’il suffit de répondre aux attentes des enseignants pour obtenir la note de passage dans ses différents cours. En ce sens, il présente le profil de ceux que Christian Baudelot et Marie Cartier nomment des élèves « réfractaires » (1998, p. 42), pour qui la lecture scolaire s’apparente à une « pratique sans croyance » (ibid.).
Renaud, pour sa part, a dix-neuf ans. Il livre peu d’informations sur son parcours scolaire mais déclare souhaiter s’inscrire à l’université dans un programme d’études qui lie l’art et la technologie.
Il mentionne avoir été un grand lecteur, principalement de romans de fantasy, quand il était plus jeune, puis s’être détourné de la lecture durant une partie de son adolescence. Il se déclare, aujourd’hui, principalement amateur de romans.
À l’école, Renaud a lu du slam (Grand Corps Malade) quand il était au secondaire. Bien qu’il ait aimé cette expérience, il n’en lit plus (pas plus que de la poésie), aujourd’hui. Ses goûts personnels le portent désormais vers ce qu’il juge être des « œuvres plus littéraires » (lors de l’entrevue, il déclare être en train de lire Chaos calme de Sandro Veronesi8)
Renaud entretient un rapport moins conflictuel qu’Anis avec la littérature, du moins avec le genre romanesque. De même, il déclare aimer s’investir dans une démarche que l’on pourrait qualifier d’herméneutique puisqu’il prend plaisir à saisir la richesse des significations des textes de ses chansons favorites. Il souligne, à ce propos, son intérêt à « souvent regarder les paroles [des chansons qu’il aime], essayer de trouver le sens, de faire [s]on propre sens ». Cela lui donne le sentiment d’« être plus proche de l’artiste, mieux comprendre qui [il] écoute ». Par ailleurs, il s’adonne, en amateur, à la peinture (dans un style proche de celui du graffiti).
4. Résultats
4.1. Premier entretien (avant le parcours sonore)
4.1.1. Résistances face au/du poème
Le choix d’un poème de Marie Uguay, parmi les trois proposés par l’équipe de recherche, nécessite un temps de réflexion pour les deux répondants. L’opération s’avère même plutôt délicate pour Anis, qui déclare qu’« [i]l n’y en pas vraiment un qui [l’]intéresse ». Il se justifie en précisant la nature des problèmes que lui posent la compréhension de la plupart des textes littéraires : « En fait, c’est juste le fait que je ne suis pas capable de visualiser ou juste de comprendre. » Il finit par opter pour le poème qui lui semble le « plus compréhensible » : « La fenêtre comme l’écran ». Toutefois, Anis peine à donner un sens à ce texte qui ne lui « évoque rien du tout » sur un plan personnel. Finalement, invité à identifier un jeu d’oppositions, un rapprochement ou une oscillation entre deux thèmes, dans ce texte, Anis met au jour une caractéristique commune à la fenêtre et l’écran, celle de donner accès à une autre réalité ou, au contraire, d’y faire obstacle, selon qu’on les ouvre ou les ferme.
Renaud sélectionne également un poème sans grande conviction. Il choisit celui intitulé « Il existe pourtant… » en invoquant des raisons assez similaires à celles d’Anis : « J’ai trouvé un peu plus de sens dans le premier que dans les deux autres. » Interrogé sur une potentielle résonance avec son propre vécu, le jeune homme considère que le texte ne fait « pas particulièrement » écho à son parcours personnel. De fait, lorsqu’on lui demande ce que le poème choisi évoque en lui ou pour lui, sa réponse montre qu’il adopte un rapport distant et objectivant à ce texte qui, selon lui, exprime simplement un « cri du cœur », une « critique envers le monde d’aujourd’hui, envers la misère ».
4.1.2. « Sujet lecteur » vs « lecteur scolaire » ?
Malgré les difficultés éprouvées par les deux répondants, ce premier contact avec l’œuvre poétique de Marie Uguay suscite, de leur part, deux attitudes assez distinctes face aux poèmes. Bien qu’il se sente peu interpellé par les poèmes de Marie Uguay, Anis se livre à une forme d’« appropriation » (Shawky-Milcent, 2014) d’un élément (le titre) du poème « La fenêtre et l’écran », qu’il interprète à l’aune de son expérience des objets du quotidien :
Anis : J’sais pas si ça compte mais le titre « La fenêtre comme l’écran ». […] La fenêtre, tu peux la refermer, comme un écran de télévision, ton téléphone. Tu peux refermer l’écran.
Chercheuse : Hum, c’est vrai, ça. Et décider de ne pas regarder ce qu’il y a à l’extérieur, finalement.
Anis : Ouais, tout comme tu peux décider de ne pas regarder ce qu’il y a sur ton téléphone ou sur la télévision.
L’hésitation marquée par Anis (« J’sais pas si ça compte ») suggère qu’il a conscience de déroger à la posture de lecture habituellement attendue en classe. De fait, Anis ne convoque aucun savoir littéraire, aucune connaissance théorique pour interpréter le titre du poème mais livre, au contraire, une lecture empreinte d’une forte subjectivité (Rouxel et Langlade, 2004 ; Langlade, 2007).
Renaud, en revanche, justifie d’emblée son choix de poème en évoquant le « contraste entre des pommes, des oranges, des fruits qui sont colorés, qui sont bons et qui sont beaux et un parallèle complètement inverse […] à la misère ». Ce faisant, il esquisse une analyse du poème, que l’on peut qualifier de formaliste et techniciste, en neutralisant toute trace de subjectivité apparente. En ce sens, Renaud aborde le poème en mobilisant un « habitus9 » (Bourdieu, 1980) de lecteur scolaire.
4.2. Second entretien (après le parcours)
4.2.1. Des réactions contrastées à l’expérience vécue lors du parcours sonore
L’un des objectifs du second entretien était d’évaluer l’appréciation des répondants à l’égard du parcours sonore en soi, mais aussi en tant que voie d’accès à l’univers poétique de Marie Uguay. Anis et Renaud fournissent, à ce propos, des réponses assez divergentes. D’une manière générale, le premier considère que le parcours sonore n’a « pas vraiment » modifié sa compréhension du poème lu précédemment ni, plus généralement, changé sa perception de la poésie comme genre littéraire. Il a éprouvé de la difficulté à se sentir interpellé par le volet sonore, en particulier la narration qui n’« était pas dynamique » et ne contenait « pas assez d’émotions ». En revanche, il déclare avoir surtout aimé explorer un nouveau quartier : « Je dirais que c’est juste la marche que j’ai appréciée. Déjà, j’ai pu voir de nouveaux endroits auxquels j’étais jamais allé. Pis, c’est tout. C’était vraiment juste la marche. La découverte du quartier. » À cet égard, le caractère in situ de l’activité semble avoir un peu favorisé l’entrée d’Anis dans le poème :
L’élément qui a fait en sorte que ça rende un tout petit peu mieux, c’est déjà le fait que, quand la femme [la narratrice], par exemple, pour l’intro, ils disaient « une maison » et on est allé voir la maison, donc je pouvais voir la maison, à quoi est-ce qu’elle ressemblait. Là, j’avais une bonne image de la maison.
Renaud, en revanche, affirme que toutes les composantes du dispositif ont contribué à une impression d’immersion qu’il a ressentie dès le début de la promenade : « C’est un mélange de tout ça ensemble qui fait un peu un sentiment de confort, avec la voix [...] je trouvais ça très chaleureux. Tout ça, ça m’a vraiment mis en confiance. » En outre, lorsqu’on lui demande si la promenade littéraire l’a conduit à percevoir autrement la poésie, il répond, de manière affirmée : « Totalement. » La suite de sa réponse invite, cependant, à faire preuve de nuance car il semble surtout percevoir positivement les modalités du parcours sonore : « Je trouve que ça peut permettre à certaines personnes de mieux apprécier la poésie, de peut-être mieux apprécier la littérature en général parce que, je pense, l’un [marcher] peut accentuer l’autre [aimer la poésie]. »
Il n’en demeure pas moins que la comparaison entre certaines réponses posées aux deux entretiens fait incontestablement ressortir un effet significatif du parcours sur la perception et l’appréciation générales de ce dernier par Renaud. En effet, alors qu’il justifie le choix de son poème, lors du premier entretien, en invoquant le fait que c’est celui qu’il comprend le mieux, Renaud, lors de la seconde entrevue, étaye sa relecture du texte par des informations entendues dans les capsules audios :
Ce qui m’a surtout aidé à mieux le comprendre, c’est d’en connaître plus sur Marie Uguay parce que t’en apprends un peu plus, quand tu connais un peu d’où elle vient et pis qu’est-ce qui lui est arrivé, bah c’est sûr que ça te permet d’avoir un œil différent sur son poème parce que tu réalises qu’elle est capable de comprendre la souffrance parce qu’elle est, elle aussi, en souffrance.
L’approche du poème adoptée par Renaud relève de ce que l’on peut appeler une démarche biographisante, fondée sur la connaissance de la vie de la poétesse et du contexte de production de son œuvre. De prime abord, cette approche suggère que Renaud conserve la posture qu’il avait lors du premier entretien, en appliquant au poème des schèmes d’intelligibilité acquis à l’école (l’enseignement de l’histoire littéraire, rappelons-le, occupant une place importante dans les cours de littérature au collégial). Cependant, l’attention portée par le jeune homme à des informations contextuelles peut tout autant procéder d’un intérêt personnel, si l’on considère que Renaud agit avec Marie Uguay de la même manière qu’avec les artistes dont il cherche à « être plus proche » afin de « mieux comprendre [qui] il écoute » (cf. supra, § 3.2).
Dans un autre ordre d’idées, être en mouvement dans la ville est perçu favorablement par Renaud, dont les propos font écho, de prime abord, à l’idée de Rachel Bouvet qu’une promenade littéraire permet de construire du sens en mobilisant ses sens :
[…] le fait de pouvoir marcher, je trouve que ça fait activer plusieurs sens plutôt que de simplement faire rouler l’esprit à lire des textes ou à lire des poèmes. […] Je trouve que ma marche était plus plaisante parce que j’écoutais quelque chose et je trouve que l’écoute était plus active parce que, justement, je marchais en même temps.
Cet extrait de l’entrevue de Renaud confirme également l’importance que ce dernier accorde au contenu informatif des capsules sonores. En fait, la marche constitue surtout, pour lui, un adjuvant de l’écoute. Elle semble même presque accessoire, si l’on considère que les éléments sur lesquels il s’appuie pour relire le poème qu’il a choisi durant la première entrevue sont principalement les données biographiques des capsules sonores.
4.2.2. Résonances poétiques
Lorsqu’on lui demande si certaines problématiques exposées lors de la promenade littéraire ont eu une résonance avec son parcours personnel, Anis répond simplement : « Non, pas vraiment. » Pourtant, si « [l]a résonance repose sur l’expérience du fait qu’un fragment du monde a en tant que tel quelque chose à nous dire, qu’il nous concerne, autrement dit : que nous lui accordons de la valeur et de l’importance en lui-même » (Rosa, 2018, p. 496), il nous semble possible d’affirmer qu’Anis a bel et bien éprouvé une forme de résonance. En effet, recueillir une trace, lors de la promenade littéraire, de ce qui évoquait à ses yeux une forme d’entredeux a conduit Anis à s’immerger aussi bien dans l’univers de Marie Uguay que dans le quartier où s’est déroulé le parcours. D’ailleurs, Anis parvient à expliquer sans difficulté son choix de photographier un élément du paysage urbain représentant une forme d’entredeux (voir photo en annexe). Il mentionne s’être arrêté devant un monument aux morts situé dans le parc Garneau car, à ses yeux, l’épée représentée dans cette stèle commémorative évoque, en tant que symbole guerrier, le courage et la soif de liberté de la poétesse affligée par une maladie incurable :
Elle [Marie Uguay], elle a dit qu’elle voulait pas de prince. Elle veut être capable de se réveiller toute seule, comme une femme indépendante, ou elle a pas besoin d’homme pour s’occuper d’elle, et tout ça. Et, sur la photo que j’ai envoyée, genre sur le côté, bah on voit une épée. Et l’épée, pour moi, ça me fait penser… j’sais pas comment l’expliquer… […] elle est capable de se relever, elle est capable de se défendre, elle est capable de se battre.
Le discours d’Anis met au jour une interprétation complexe et personnelle, à la fois des éléments entendus (lors de l’écoute de la capsule sonore) et vus (dans l’espace urbain) qu’il met en relation et reconfigure en investissant dans ce processus de construction de sens sa propre subjectivité. À cet égard, sa conception de l’entredeux, envisagée comme une tension entre deux pôles, comme une fusion des opposés, est originale en ce qu’elle révèle que, pour Anis, le monument aux morts est moins un lieu de recueillement en mémoire des disparus qu’une célébration du désir de liberté et de résistance face à l’adversité, autrement dit un hommage à la pulsion de vie.
Par ailleurs, la déambulation dans l’arrondissement de Ville-Émard, et « la découverte du quartier », tout au long du parcours balisé de la promenade littéraire, engagent le jeune homme dans une forme de « lecture sensible orientée » (Miaux et Roulez, 2014, p. 90). Lorsqu’on lui demande, lors de la seconde entrevue, quelles formes d’entredeux il a perçues dans le paysage urbain, il se montre assez volubile et souligne spontanément, par exemple, le contraste entre diverses attitudes et émotions perçues parmi les gens croisés (par exemple, certains qui semblaient heureux et d’autres qui avaient l’air maussades). Cette réaction atteste que le lien créé entre Anis et le monde qui l’entoure a constitué un foyer de résonance et que le dispositif du parcours sonore a permis au répondant de porter un regard intensifié sur les lieux traversés et les personnes côtoyées.
Renaud, pour sa part, fixe une représentation plus immédiate d’une forme d’entredeux, puisqu’il prend une photographie depuis une passerelle enjambant le canal Lachine (voir photo en annexe). Il justifie son choix en faisant référence explicitement, de nouveau, au contenu des capsules sonores :
C’est comme si, dans son quartier, donc du côté gauche, elle se sent vivante, et du côté droit, c’est comme si je le voyais, au moment où je l’écoutais, un peu comme si, du moment où, en dépassant le pont, c’est là qu’elle décidait de mourir, en soi, comme le nom de la capsule qui est « Entre la vie et la mort ». Donc, elle se retrouve vraiment entre les deux.
Contrairement à ce que l’on observe avec Anis, le motif de l’entredeux, pour Renaud, suggère une tension, voire une disjonction entre deux pôles radicalement distincts, le premier associé à la nature et à la vitalité, le second à l’industrialisation et à la mort.
Néanmoins, l’entrevue fait apparaitre l’amorce d’un changement dans la posture de Renaud à l’égard des poèmes et, plus largement, de l’univers de Marie Uguay. En effet, il reprend à son compte le motif de l’entredeux, dont il se sert pour métaphoriser sa propre expérience de résonance lors du parcours sonore : « […] je me retrouvais entre les paysages que je voyais, les lieux que je voyais et ce que j’écoutais, ce que j’entendais. Donc, j’étais vraiment le médium entre ces deux-là pour lier les deux. […] J’étais l’entredeux. ».
S’il se montre moins éloquent lorsqu’il évoque d’autres moments de résonance vécus durant le parcours sonore, Renaud nous permet, toutefois, d’observer clairement son investissement subjectif dans sa manière de « s’approprier » l’univers poétique de Marie Uguay. À cet égard, il est intéressant de relever que Renaud, contrairement à Anis, s’appuie beaucoup sur les données biographiques contenues dans les capsules sonores. Cependant, à l’aune des nouvelles connaissances acquises grâce aux capsules sonores, Renaud investit le poème d’une manière totalement différente de celle adoptée lors de la première lecture. Alors que, avant le parcours, le poème qu’il a choisi ne résonne « pas particulièrement » avec son propre vécu, lors du second entretien, Renaud parvient à faire émerger de nouvelles significations :
Comme elle dit elle-même, par exemple quand elle se compare à un fruit, c’est qu’elle a tellement de vigueur qu’elle veut le partager, qu’elle se doit de le partager. Elle souffre mais, par sa souffrance, elle véhicule sa souffrance par l’amour, j’ai l’impression.
Ce passage de la seconde entrevue est particulièrement révélateur d’une évolution progressive entre une lecture centrée sur le texte (« Comme elle dit elle-même, par exemple quand elle se compare à un fruit… ») et une « mise en jeu d’une expérience subjective de lecture » (Fourtanier, 2017, p. 79), qui apparait explicite dans les derniers mots de l’extrait (« Elle souffre, mais, par sa souffrance, elle véhicule sa souffrance par l’amour, j’ai l’impression… »).
Cette évolution est plus manifeste encore lorsque Renaud signale être particulièrement interpellé par des thématiques qu’il inscrit au cœur de sa pratique artistique et qu’il retrouve dans l’œuvre de la poétesse :
Elle parle beaucoup du désir amoureux qui est très, très fort. Pis, elle avait une manière de formuler ça où elle essaie de dire que l’amour est un peu la clé, qu’elle est un peu la réponse à tout, […] pis ça, personnellement, ça résonne beaucoup dans ma vie, dans mon parcours en général parce que c’est quelque chose que j’essaie de prôner le plus possible. [...] et que j’essaie le plus possible de croire, surtout dans ma démarche artistique qu’est la peinture.
Cette fois, Renaud ne se fonde plus sur un repérage de procédés formels ou sur une mise en contexte du poème. En revanche, son discours recèle plusieurs indices de l’« activité fictionnalisante » (Langlade, 2007) du jeune homme, en particulier une « concrétisation imageante » (« c’est comme si je le voyais, au moment où je l’écoutais ») et une « activation fantasmatique » (« elle essaie de dire que l’amour est un peu la clé, qu’elle est un peu la réponse à tout, […] pis ça, personnellement, ça résonne beaucoup dans ma vie, dans mon parcours »).
Les réponses fournies par Renaud lors de sa seconde entrevue révèlent comment la relation qu’il a instaurée entre sa propre subjectivité et celle de Marie Uguay l’a conduit, au terme du parcours sonore, à passer d’une lecture objective et rivée aux aspects formels ou sociohistoriques du poème à une approche plus sensible. Cette nouvelle manière d’aborder le texte est également plus « résonante » si l’on en juge aux marques d’affects qui parsèment le discours du répondant, ainsi qu’aux liens que ce dernier établit entre ce que le texte lui évoque et son propre vécu. En d’autres mots, en comprenant mieux le poème, c’est-à-dire, au sens étymologique du terme, en le prenant avec soi, Renaud l’a « transform[é] en une partie de [lui]-même, en une composante de ce qu’[il] est » (Shawky-Milcent, 2014, p. 18).
5. Discussion
En dépit de la taille modeste de notre échantillon de répondants, notre recherche nous permet de formuler un certain nombre de constats et de questions. Nous commencerons par mettre en évidence ce que plusieurs travaux ont déjà signalé : la faible appétence à l’égard de la poésie, comme genre littéraire, et la difficulté éprouvée par nos répondants à donner du sens à un texte poétique.
Ce constat initial nous amène à souligner l’importance de réfléchir à des stratégies de médiation et d’étayage afin, non seulement, de déconstruire des représentations stéréotypées (tant chez les élèves que chez les enseignants, si l’on se fie aux paroles de deux d’entre eux mentionnées en introduction). Or, l’enseignement de la poésie au collégial n’est que très peu documenté et étudié.
Nos résultats montrent que de nouvelles approches de la poésie peuvent permettre à des élèves de renouer avec cette dernière, même si elle se situe « hors du livre » (Labonté, 2014). Certes, de prime abord, la perception d’Anis de l’œuvre poétique de Marie Uguay, et même de la poésie comme genre littéraire, varie assez peu entre le début et la fin de l’expérimentation. Quant à Renaud, il apparait difficile de déterminer si l’enthousiasme que ce dernier manifeste au terme du parcours sonore est susceptible de faire naitre un intérêt pour un genre littéraire pour lequel le jeune homme déclare, lors du premier entretien, n’avoir que peu de goût. Néanmoins, les deux participants semblent avoir fortement apprécié le fait de marcher en poésie, d’habiter les textes et les lieux traversés (le temps du parcours sonore) tout autant que d’être habités par eux. C’est particulièrement le cas de Renaud qui, rétrospectivement, considère « être l’entredeux » lors de la promenade littéraire mais aussi, de manière plus subtile, celui d’Anis, dont le regard sur le monde qui l’entoure témoigne d’une réelle attention aux liens potentiels entre l’univers poétique de Marie Uguay, son propre monde intérieur et les lieux traversés tout au long de la promenade. En ce sens, le parcours sonore Marcher avec elle a effectivement offert à Anis et Renaud la possibilité de faire l’expérience de ce que Rachel Bouvet désigne comme « une lecture augmentée d’un texte ou d’un lieu » (2019, p. 110).
De plus, la comparaison entre les réponses fournies lors des deux entrevues révèle une légère évolution dans la manière dont les deux répondants abordent les poèmes. Ce changement est caractérisé par un investissement subjectif plus marqué lors de la seconde lecture du poème choisi au début de l’expérimentation. C’est surtout manifeste dans le cas de Renaud, d’une part parce que les réponses que ce dernier fournit sont plus détaillées, d’autre part, parce que, contrairement à Anis qui se livre à une lecture plus subjective dès la première entrevue, il insère fréquemment dans son discours des références à des éléments formels ou thématiques explicites et se tient à distance du poème, lorsqu’il est interrogé pour la première fois. En revanche, après le parcours sonore, Renaud intègre dans ses réponses de nombreux liens avec son propre vécu et propose des interprétations plus personnelles du poème de Marie Uguay.
Nous sommes enclins à attribuer cet effet non seulement aux caractéristiques du parcours sonore en tant que tel, mais aussi à la tâche associée au parcours (la photographie d’une forme d’entredeux), qui a amené les élèves à se situer au cœur de l’interrelation entre leur monde et celui de Marie Uguay. Force est de constater, néanmoins, que, même si, selon Hartmut Rosa, la résonance nait d’une dynamique qui nous transforme au contact d’une différence, une altérité trop importante peut conférer au texte poétique une forme d’opacité qui entrave le processus de résonance. Le cas d’Anis, par exemple, invite à réfléchir à d’autres dispositifs d’accompagnement du marcheur qui tiennent compte de la diversité des profils d’élèves.
Enfin, le choix de faire écouter un enregistrement grâce à un casque audio, lors du parcours, présente, inévitablement, certaines limites. On pourrait, par exemple, imaginer faire vivre l’expérience à un groupe et en direct avec un animateur qui présente l’équivalent du contenu audio, comme dans « La promenade des écrivains », conçue et élaborée par l’écrivaine et journaliste littéraire Marie-Ève Sévigny (Bouvet, 2019, p. 120). Cela permettrait d’envisager des interactions entre les participants ou avec l’animateur, et ainsi faire naitre d’autres sources de résonance (notamment grâce à l’émergence de liens fondés sur l’échange entre les participants ou avec l’animateur). Toutefois, les modalités du parcours sonore Marcher avec elle visent d’autres objectifs. D’une part, « l’interaction entre la littérature et le lieu suscite une nouvelle expérience de lecture/écoute du texte » (ibid., p. 132) ce qui peut s’avérer bénéfique sur un plan didactique, dans la mesure où la plupart des élèves entretiennent des préjugés à l’endroit de la poésie. D’autre part, marcher en solo, muni d’un casque, permet de faire l’expérience d’« une immersion qui se révèle par l’amplification de certains sens […] ou l’épanouissement de l’ensemble des sens tout au long de la marche » (Miaux et Roulez, 2014, p. 90). Dans cette perspective, la relation établie entre l’œuvre poétique de Marie Uguay et les lieux traversés tend à amener les élèves à « intensifier le rapport entre la littérature et l’espace vécu » (Bouvet, 2019, p. 134) afin de leur permettre de prendre conscience que la poésie, telle que la conçoivent Marie Uguay tout aussi bien que Véronique Côté, n’est pas séparée de la vie.
Conclusion
Faisant écho aux propositions de Véronique Côté, le parcours sonore Marcher avec elle concrétise la possibilité de quitter l’espace de la classe pour aborder ailleurs, mais aussi autrement, le genre poétique. De fait, cette promenade littéraire propose d’entrer en relation avec une œuvre et un quartier de manière multimodale, en arrimant pleinement le sens aux sens.
Par ailleurs, comme le rappelle Stéphanie St-Onge, la poésie exige « un long apprivoisement » (St-Onge, 2018, n. p). En ce sens, amener les élèves à s’engager dans une activité continue et à s’immerger durant près de deux heures dans un univers poétique constitue un premier pas significatif. Une telle activité permet, en effet, d’éprouver une forme de décélération sans laquelle, selon Hartmut Rosa, il est impossible d’entrer en résonance avec le monde qui nous entoure.
Bien qu’exploratoire, notre recherche fait émerger des perspectives pour de futurs travaux. Pour commencer, il faut reconnaitre que si « toute conversation stimulante démarre par une forme de différence ou de désaccord » (Rosa, 2023, n. p.), l’altérité peut s’avérer difficilement surmontable, ou trop déroutante, et nuire à l’émergence de la résonance (comme dans le cas d’Anis). Cela n’empêche toutefois pas de souligner plusieurs constats stimulants. Même si Anis s’est montré plus nuancé que Renaud, l’un et l’autre ont mentionné leur intérêt pour les modalités du parcours sonore et ont insisté sur les bénéfices de pouvoir vivre in situ et en mouvement l’expérience de la poésie de Marie Uguay. Comme le déclare Renaud à la fin de son entrevue, cela a permis de « mettre [s]on cerveau en marche ». À cet égard, compte tenu de l’engouement des enseignants québécois pour le balado10 (Mahieu, 2023), ce type de parcours sonore pourrait constituer une ressource pédagogique intéressante.
Renaud a également mis l’accent sur le rôle rassurant de la narration, qui lui a permis de se sentir immédiatement « en confiance ». Cette réaction renvoie implicitement à celle d’Anis, lorsque ce dernier mentionne ne pas savoir si la réponse qu’il s’apprête à donner est valide. Aborder la poésie grâce à des promenades littéraires comme Marcher avec elle permet sans doute de susciter des prises de paroles plus libres et fondées sur d’autres rapports au texte que ceux généralement imposés dans un cadre scolaire traditionnel et courant.
Toutefois, il est tout aussi important de souligner le rôle de l’entrevue (et de sa forme, en l’occurrence semi-structurée et libre), dans notre recherche, qui a permis aux participants d’adopter une posture réflexive sur leur démarche et leur expérience. Le questionnement, les relances, autrement dit le dialogue avec les élèves interrogés, constituent précisément, selon Rosa (2023), des dynamiques propices à la résonance. En ce sens, l’entrevue a prolongé et amplifié l’expérience vécue par les participants depuis le début de la recherche. Cela nous conduit à réfléchir également à l’importance de la relation dialogique à établir en classe11 : rendre non seulement la vie, mais la poésie habitable requiert de l’enseignant ou l’enseignante d’amener ses élèves à « guetter les signes », comme le dit Véronique Côté, c’est-à-dire à poser sur les textes poétiques un regard renouvelé et intensifié par leurs expériences intimes de marcheurs dont « l’œil écoute » (Claudel, 2014).